Les inégalités professionnelles entre les sexes peinent à se réduire
29 avril 2016 - 09:59
Plus diplômées qu’il y a 30 ans, les femmes sont aujourd’hui plus actives. Mais elles le sont toujours moins que les hommes, bien que plus diplômées qu’eux. Si les femmes sont plus touchées que les hommes par le chômage de longue durée, des inégalités existent aussi dans l’emploi. Ainsi, l’éventail des métiers exercés par les femmes est nettement plus réduit. Leurs conditions d’emploi sont plus souvent précaires et elles occupent plus fréquemment des postes déclassés, c’est-à-dire dont le niveau de qualification est inférieur à leur niveau de formation. Les jeunes femmes se positionnent davantage sur des postes qualifiés que leurs aînées mais le plafond de verre reste présent.
Plus présentes sur le marché du travail qu’il y a 30 ans, les femmes demeurent toujours moins actives que les hommes : entre 15 et 64 ans, 68 % des femmes le sont en 2012 en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (LRMP), soit 7 points de moins que les hommes. Les écarts entre les sexes sont un peu plus importants dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude et le Gard et dans le Tarn-et-Garonne.
Le taux d’activité des jeunes femmes est plus faible que celui des jeunes hommes : les garçons, plus présents dans les filières d’études courtes, entrent plus tôt dans la vie active. À l’âge de la maternité, certaines femmes s’éloignent de la vie active pour élever leurs enfants. Les générations de femmes de 50 à 55 ans ont été plus nombreuses que leurs cadettes à rester au foyer. À niveau de diplôme et situation familiale comparables, l’écart d’activité entre les sexes s’accentue avec l’âge.
Aujourd’hui, les femmes sont bien plus diplômées qu’il y a 30 ans : en 2012, 28 % des femmes de 15 à 64 ans en LRMP sont titulaires d’un diplôme supérieur au bac, soit quatre fois plus qu’en 1982. Plus qualifiées aujourd’hui, les femmes sont aussi plus actives. À âge et situation familiale identiques, la probabilité d’être active est bien plus faible pour les femmes peu diplômées que pour celles titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur (14 points de moins). Cette probabilité ne baisse que de 6 points pour les hommes dans les mêmes conditions.
Les femmes sont un peu plus exposées que les hommes au chômage de longue durée (52 % des inscrits depuis de 1 an à moins de 2 ans). Ce phénomène touche les femmes très diplômées comme les moins diplômées. Entre 2009 et 2014, alors que l’évolution du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi reste importante (+ 7 % par an sur ces cinq ans tous sexes confondus), la part des femmes parmi eux reste stable. Elle augmente légèrement dans le Lot, l’Hérault et l’Aveyron.
Les femmes s’orientent davantage dans les services à la personne, la santé, l’action sociale, l’enseignement et les banques ou assurances. Pour atteindre la mixité au niveau des métiers, il faudrait en théorie réorienter près de 26 % de la main-d’oeuvre masculine et féminine. Cinq métiers emblématiques, aide à domicile (y compris assistante maternelle), aide-soignant, agent d’entretien, infirmier (y compris sage-femme), très féminins d’une part et conducteur de véhicule, très masculin d’autre part, pèsent le plus dans cette ségrégation professionnelle.
Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes, que ce temps partiel soit choisi ou subi : une femme salariée sur trois contre seulement 8 % des hommes salariés. Les contrats à durée limitée caractérisent les formes particulières d’emploi des hommes, ainsi que les contrats d’apprentissage en début de carrière. En 2012, en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, une femme salariée ou exerçant une profession libérale sur trois est déclassée, c’est-à-dire occupe un poste de niveau inférieur à celui auquel elle pourrait prétendre compte-tenu de son niveau de diplôme, contre un homme sur quatre. Plus de la moitié (53%) des femmes titulaires d’un diplôme équivalent ou supérieur au 2e cycle universitaire occupent un poste déclassé contre seulement 31 % des hommes de même niveau. À l’opposé, le surclassement qui bénéficie plus aux hommes qu’aux femmes, constitue un autre facteur d’inégalité.
Les jeunes générations de femmes investissent davantage certains métiers plus qualifiés. Ainsi, parmi les jeunes cadres de moins de 30 ans, 42 % sont des femmes en 2012 dans la région, soit 3 points de plus que pour leurs aînées. Cependant, en Haute-Garonne, la part de jeunes femmes cadres est plus faible que dans la région. Pourtant, les Haut-Garonnaises figurent parmi les femmes les plus diplômées de France. L’orientation des femmes dans le cursus scolaire et le plafond de verre peuvent en partie expliquer ce paradoxe, dans un département où l’industrie et les fonctions stratégiques sont plus présentes.



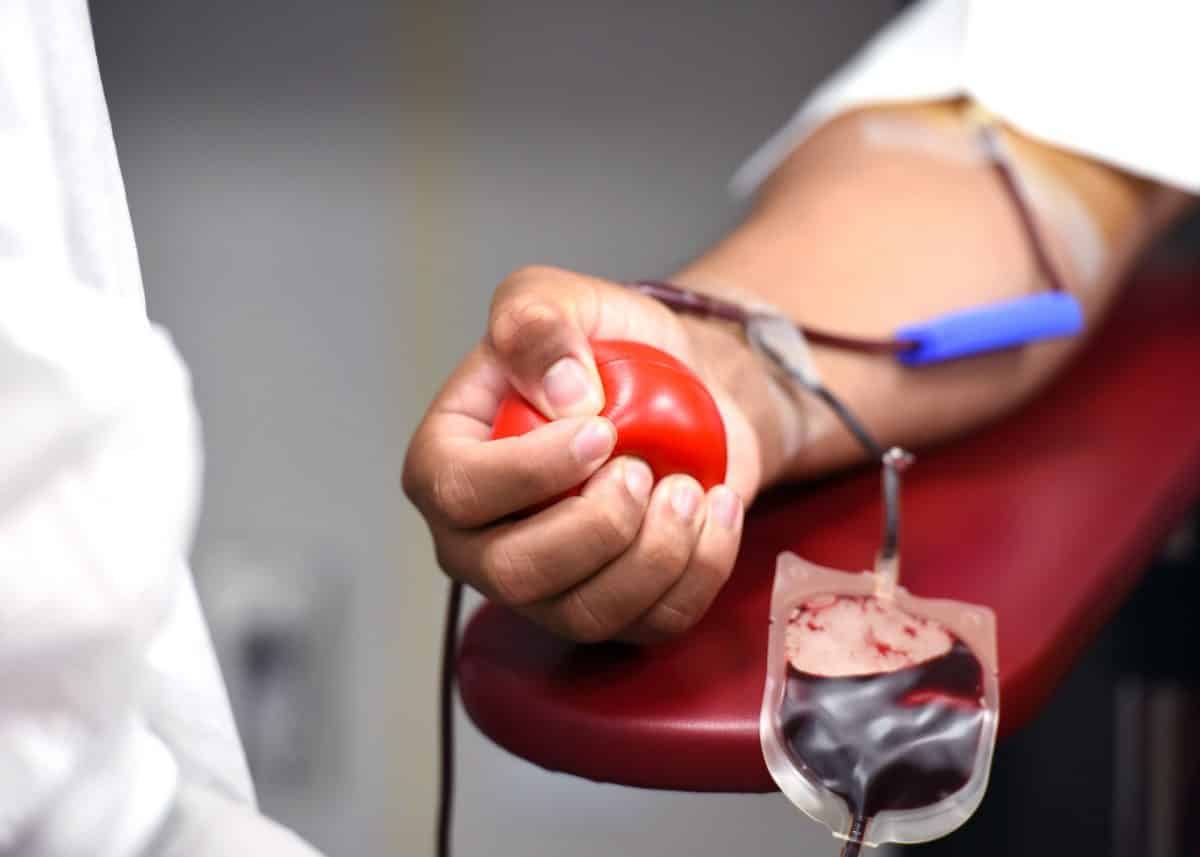





Commentaires