[Interview] Un risque très élevé de tsunami sur les côtes méditerranéennes d’Occitanie
24 novembre 2022 - 09:18
Selon l’Unesco, le risque qu’un tsunami survienne en Méditerranée au cours des trente prochaines années est proche de 100% ; et les côtes d’Occitanie ne devraient pas être épargnées, comme nous l’explique Hélène Hébert, coordinatrice nationale du Centre d’alerte aux tsunamis (Cenalt). Elle revient sur l’ampleur que devrait prendre le phénomène et la manière de s’en protéger.

Hélène Hébert, l’Unesco a alerté quant à une probabilité proche de 100% pour qu’ait lieu un tsunami en Méditerranée au cours des 30 prochaines années. Confirmez-vous cette information ?
Tout à fait, d’autant qu’il y a des tsunamis en Méditerranée très régulièrement. Sur les 30 dernières années, nous en avons recensé une dizaine. Ils restent assez modérés et finalement peu médiatisés. C’est en Méditerranée orientale, en Grèce et en Turquie qu’ils sont les plus nombreux. Pour exemple, depuis 2017, nous en avons observé trois notables en mer Égée, là où l’activité sismique est la plus importante. Un séisme étant la principale cause à l’apparition d’un tsunami.
Nous ne pouvons pas prévoir les séismes. En revanche, nous savons que, sous l’eau, ils se reproduisent toujours dans les mêmes zones, sur des failles. Ainsi, nous pouvons prédire où ils vont se produire… mais pas quand. C’est ainsi que nous sommes certains que des tsunamis auront lieu en Méditerranée.
Voici à quoi s’attendre
De quoi parle-t-on exactement ? Quelle serait l’ampleur du phénomène en Méditerranée ?
Un séisme sous-marin déforme le fond de la mer et toute la couche d’eau qui se trouve au-dessus se met alors à osciller pour créer un front d’ondes, de vagues qui vont se propager dans toutes les directions. Pour comparaison, c’est un peu comme lorsqu’on lance un caillou dans un plan d’eau : on observe autour du point de chute, des ondes concentriques qui se propagent. Les effondrements sous-marins peuvent également provoquer des tsunamis.
Ceci étant précisé, il est important de dire que les tsunamis qui auront lieu en Méditerranée n’ont rien à voir avec ceux qui ont frappé certaines régions d’Asie dernièrement. Le principe reste le même, mais à des échelles plus réduites. Ainsi, les phénomènes que l’on a pu observer au Japon ou dans l’océan Indien, avec des hauteurs de vagues de plus de 15 mètres, n’ont rien de comparable avec ce que nous prévoyons en Méditerranée. Toutefois, au large de la Grèce, une plaque tectonique passe sous une autre (zone de subduction) ce qui peut présager de très forts séismes. Mais contrairement au Japon où ils ont lieu plusieurs fois par siècle, en Grèce ils ont lieu tous les 1 000 ans. Les risques sont donc plus faibles.
En Méditerranée, on peut donc évoquer des tsunamis de l’ordre de un à deux mètres. Le phénomène sera alors comparable à la crue d’une rivière : la mer inondera les plages, les ports, les rues proches du rivage. Mais si les vagues ne seront pas très hautes, les courants associés eux seront puissants : de l’ordre de 30 à 40 kilomètres-heure. À cette vitesse, l’eau emporte tout sur son passage ce qui peut engendrer de gros dégâts matériels et humains potentiellement. D’autre part, un tsunami n’est pas constitué que d’une seule vague, mais de plusieurs, qui se reproduisent plusieurs fois, pendant plusieurs heures. Et la première n’est pas forcément la plus forte. Il est donc préférable de s’éloigner du rivage pendant plusieurs heures lors d’un tel phénomène.
« Si les vagues ne seront pas très hautes, les courants associés eux seront puissants : de l’ordre de 30 à 40 kilomètres-heure »
La Grèce est donc une région à risque. Qu’en est-il en France ?
La France est un pays sismique. De forts séismes (jusqu’à 6.5 de magnitude) ont notamment été enregistrés dans la région de Nice. S’ils se produisent en mer, un train de vagues peut être généré. Celui-ci déferlera sur la Côte d’Azur. Comme cela a été le cas en 1979, à Antibes (11 morts, NDLR), suite à un effondrement sous-marin.
De même, de nombreux séismes, qui peuvent atteindre une magnitude de 5 ou plus, ont lieu en Algérie. Selon le même schéma, s’ils surviennent au large, un tsunami peut être généré et traverser toute la Méditerranée, frappant les Baléares, la Sardaigne et les côtes d’Occitanie. Ces dernières seront atteintes par les vagues environ une heure après le séisme.
L’Occitanie ne sera pas épargnée

La région Occitanie, dont les départements des Pyrénées-Orientales, de l’Aude, de l’Hérault et du Gard ont les pieds dans la Méditerranée, est donc à risque pour les tsunamis ?
Nous manquons d’observations sur cette zone. Mais notre rôle consiste aussi à modéliser des scénarios possibles. Ainsi, nous savons que de nombreux séismes ont déjà eu lieu au large de l’Algérie et qu’ils se reproduiront aux mêmes endroits. La seule inconnue étant la date et la force de ces derniers. Or, c’est la puissance du séisme qui déterminera l’apparition d’un tsunami qui pourrait impacter les côtes du Languedoc.
Cependant, les modélisations que nous avons pu réaliser sur l’Occitanie montrent que la configuration sous-marine du golfe du Lion, constitué de multiples canyons, puis d’une zone assez plate juste avant la côte, aurait tendance à ralentir, à atténuer le phénomène. Cela dit, nos projections font également état d’une exposition plus importante de certaines villes comme Sète. Nous y avons observé un petit tsunami, avec des vagues de 30 à 40 centimètres, en 2003, après un séisme en Algérie d’une magnitude de 6,8. Ainsi, comme ce qui s’est produit se reproduira, nous pouvons confirmer qu’un même événement, d’une magnitude supérieure (jusqu’à 7,4), engendrera des vagues de un à deux mètres dans le port de Sète.
« Un séisme en Algérie d’une magnitude 7 engendrera des vagues de un à deux mètres dans le port de Sète »
Quels types de dégâts une vague de un à deux mètres peut-elle entraîner ?
Visuellement, cela pourrait ressembler à ce que l’on connaît lors des fortes crues de rivière. Mais ce sont les courants qui seront les plus impressionnants et les plus destructeurs. Ils embarquent tout sur leur passage, le mobilier urbain, les voitures, et même les personnes qui peuvent être fauchées par la ou les vagues. Dans ce genre de flux hydraulique, seuls 50 centimètres d’eau peuvent suffire à faire tomber un individu. Au-delà du risque pour un piéton de se faire emporter par les courants existe celui de se faire blesser par les objets charriés par les eaux.
Peu de gens en Occitanie savent comment réagir

Comment peut-on se protéger d’un tsunami ? Quels sont les systèmes d’alerte existants ?
L’Unesco coordonne tous les systèmes d’alerte du monde. Depuis le séisme puis le tsunami catastrophique qui ont eu lieu en 2004 dans l’océan Indien, des systèmes d’alerte ont été installés dans tous les océans car, même si ce phénomène est rare et essentiellement observé dans le Pacifique, il peut survenir partout. De son côté, la France a mis en place son propre système d’alerte en 2012.
Au Centre d’alerte aux tsunamis (Cenalt), nous réalisons de la surveillance sismique à l’aide de capteurs placés autour de la Méditerranée. Nous savons ainsi qu’un séisme a eu lieu quelques minutes après. Nous pouvons le localiser précisément et connaître sa magnitude très rapidement. Nous pouvons également, en quelques minutes, savoir si un tsunami a été généré ou pas. De même, nous observons le niveau de la mer dans les ports équipés de marégraphes. En croisant toutes ces mesures, nous sommes ainsi capables de prévoir qu’une région va être impactée par un tsunami dans les 15 minutes qui suivent le séisme. Nous envoyons ensuite un message à la Sécurité civile chargée d’organiser des évacuations si besoin. Celles-ci étant déclenchées par la mise en route de sirènes, et des messages d’alerte envoyés sur les smartphones.
« Nous sommes capables de prévoir qu’une région va être impactée par un tsunami dans les 15 minutes qui suivent le séisme »
Les habitants et les communes d’Occitanie, qui n’ont pas l’habitude d’être confrontés à ce type de phénomène, sont-ils suffisamment sensibilisés aux risques ?
Effectivement, une fois l’alerte lancée, encore faut-il savoir ce qu’il convient de faire. Et, probablement que les habitants des communes d’Occitanie situées sur le pourtour de la Méditerranée ne sont pas suffisamment préparés au risque de tsunami car la culture sismique est moins présente dans cette région. Avec le ministère de l’Écologie, la Sécurité civile et les communes potentiellement concernées, nous travaillons sur la prévention des risques en organisant des exercices, en mettant en place la signalisation appropriée pour les évacuations et en sensibilisant la population. Et ce, depuis une dizaine d’années.
Toutes les préfectures, et tous les maires des communes concernées en Occitanie, reçoivent les messages d’alerte. Mais toutes ne sont pas prêtes à les gérer. D’où l’importance d’un d’une sensibilisation accrue et de la vulgarisation scientifique. Un travail de longue haleine mais qu’il est important de mener pour la sécurité des habitants.




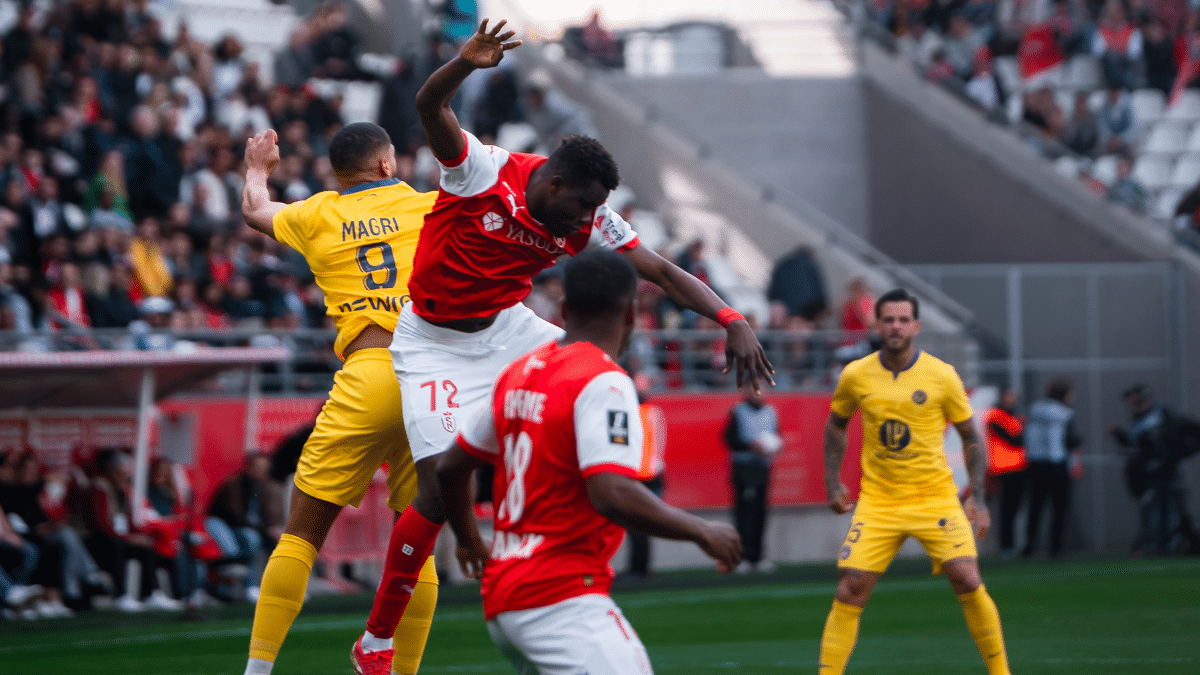
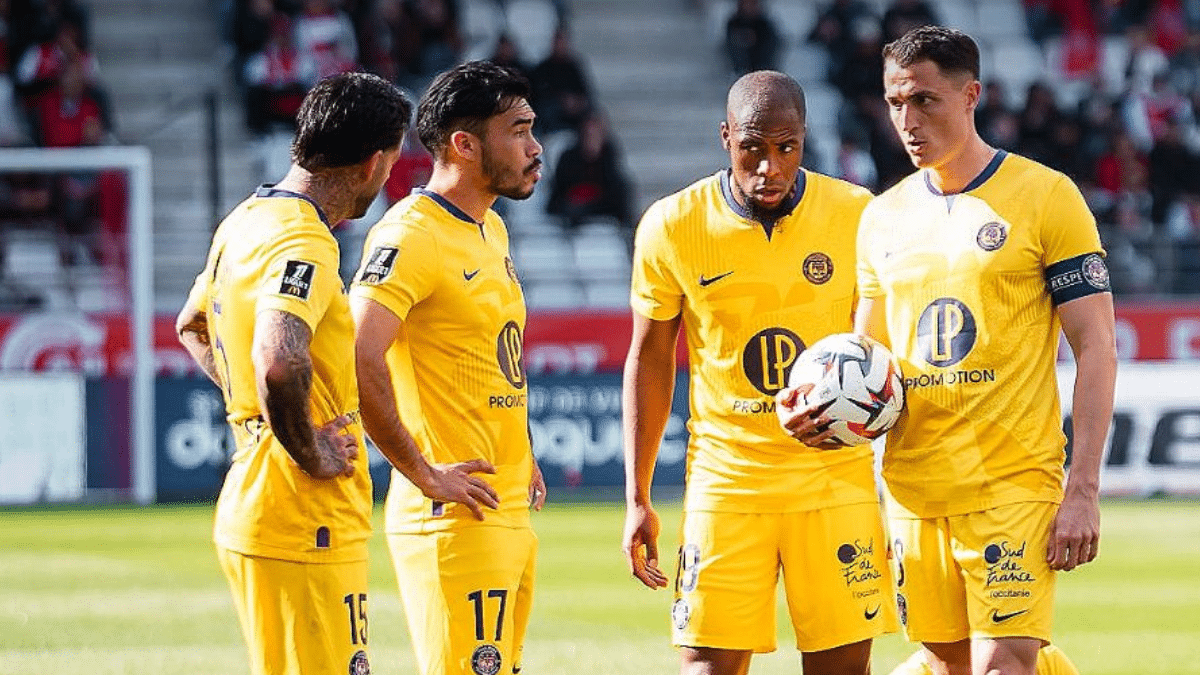


Commentaires