Suicide chez les agriculteurs : comment prévenir le passage à l’acte ?
17 octobre 2023 - 15:27
Le suicide est la troisième cause de mortalité des agriculteurs. Afin d’enrayer le phénomène, un plan de prévention, composé notamment de cellules d’accompagnement, a été mis en place en 2011. Ils sont actuellement près d’une centaine d’agriculteurs en ex Midi-Pyrénées à être accompagnés par ce programme.

Grippe aviaire, sécheresse et maintenant maladie hémorragique épizootique… Autant d’aléas qui causent un stress supplémentaire aux agriculteurs et qui, ajoutés à d’autres problèmes peuvent conduire à la dépression voire au suicide. « Les agriculteurs subissent des difficultés économiques, de travail ou personnelles. Et quand la coupe est pleine, les gens préfèrent se supprimer », déplore Laure Serres, la présidente de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de Haute-Garonne (FDSEA 31). Ainsi, tous les deux jours, un agriculteur se donne la mort. Ce qui fait du suicide la troisième cause de décès de cette profession, après les cancers et les affections de l’appareil cardio‑vasculaire. Il arrive seulement à la sixième place dans le reste de la population française.
Les agriculteurs ont donc un risque bien plus élevé de se donner la mort. Pour preuve, leur surmortalité par suicide était supérieure de 20% par rapport à la population générale en 2010, selon Santé publique France qui n’a pas publié de chiffres plus récents depuis. Les agriculteurs ne sont pas tous exposés au même risque. En effet, les hommes exploitants agricoles, surtout ceux âgés de 45 à 64 ans, sont davantage concernés par la surmortalité par suicide. Et si l’on regarde par type d’activité agricole, ce sont les éleveurs, principalement bovins, qui sont les plus touchés. L’élevage bovins-viande et l’élevage bovins-lait présentent un excès de suicide respectif de 57% et 47% par rapport à la population française en 2009. « Les éleveurs ont une pression supplémentaire car ils travaillent avec des animaux », estime Laure Serres.
Ce qui est mis en place pour prévenir le suicide agricole
Face à ce phénomène, la Mutualité sociale agricole (MSA), le régime de protection sociale obligatoire des personnes salariées et non salariées des professions agricoles, a mis en place en 2011 un plan de prévention du suicide dans le monde agricole. Ce dernier est composé de cellules pluridisciplinaires de prévention au sein de chaque MSA pour identifier les agriculteurs en difficulté. « Celles-ci sont entre autres composées de médecins du travail, de psychologues, de travailleurs sociaux, de conseillers en prévention », détaille Laurence d’Aldéguier, la présidente de la caisse MSA Midi-Pyrénées Sud. Ces cellules reposent, notamment sur un réseau de sentinelles, composé d’une trentaine de personnes dans l’ancienne région, qui côtoient des agriculteurs au quotidien et vont pouvoir repérer leur mal-être.
Ces sentinelles passent ensuite le relais aux cellules d’accompagnement, qui après analyse de la situation de l’agriculteur, mettent en place un plan d’action « adapté à chacun », assure la présidente de la caisse MSA Midi-Pyrénées Sud. Elle poursuit : « Généralement, nous orientons les personnes en difficulté vers l’action sociale. Nous vérifions qu’elles aient bien ouvert tous leurs droits sociaux. Nous leur proposons également de l’aide au répit. En clair, nous finançons en totalité le salaire de quelqu’un qui va venir remplacer l’exploitant durant quelques jours pour qu’il puisse souffler. Nous proposons par ailleurs des séances de sophrologie ou chez un psychologue, des séjours pour partir en vacances ou encore des aménagements de cotisations sociales », liste Laurence d’Aldéguier.
Actuellement, 95 personnes sont suivies par la cellule pluridisciplinaire de prévention de la MSA Midi-Pyrénées Sud. « Cela peut monter jusqu’à 120. Nous sommes de plus en plus sollicités car le monde agricole fait face à davantage de difficultés », note Laurence d’Aldéguier en citant notamment les épidémies qui touchent les élevages ou la sécheresse. Et lorsqu’une crise touche le territoire, la MSA prend les devants. Durant l’épidémie de grippe aviaire dans le Gers en janvier dernier, la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud a ainsi contacté tous les exploitants concernés par des zones de contrôle. « Soit 240 personnes. Cela a permis aux exploitants de partager leurs difficultés et d’échanger à ce sujet lors de réunions », rapporte Laurence d’Aldéguier.
En plus de ces cellules pluridisciplinaires, la MSA a également déployé Agri’écoute, un numéro d’écoute pour les agriculteurs en situation de détresse psychologique, en 2014 dans le cadre de son plan de prévention. Ce service leur permet de dialoguer anonymement 24h/24 et 7j/7 avec des écoutants formés aux situations de souffrance ou de détresse. En ex Midi-Pyrénées, 28% des appelants avaient entre 41 et 50 ans en 2022, étaient principalement des hommes (52%) et des éleveurs (55%) et se trouvaient pour la plupart en Haute-Garonne. Mais tous les agriculteurs qui vont mal n’ont pas le réflexe d’appeler ce numéro. « Certains ne veulent pas parler. Il est donc difficile d’aller vers eux », révèle la présidente de la FDSEA 31.
La FDSEA demande une réelle prise de conscience de la part de l’État
D’ailleurs, si Laure Serres salue les différents dispositifs de prévention du suicide dans le monde agricole, elle estime que l’État devrait faire plus face à ce phénomène. « S’il n’y a pas de volonté politique de mettre des choses en œuvre pour que l’agriculture française soit mise en valeur, le taux de suicide des agriculteurs ne baissera pas », estime-t-elle. La présidente de la FDSEA 31 déplore ainsi « la non-considération » envers leur profession. « Nous nous endettons pour notre outil de travail, travaillons 80 heures par semaine et sommes payés la moitié d’un SMIC. Mais cela n’émeut personne », regrette Laure Serre. « Si nous ne sommes pas mieux considérés, qu’au moins on ne nous montre pas du doigt », demande-t-elle en déplorant l’agribashing dont la profession est victime.
Et à ce manque de considération vécu par les agriculteurs, s’ajoute la pression de la réglementation. La présidente de la FDSEA 31 dénonce ainsi « des mesures européennes déjà contraignantes » auxquelles s’ajoute la norme française. « On nous impose des dates, comme l’interdiction de labourer avant le 15 octobre ou le 1er novembre, ou de ne pas utiliser de l’engrais avec azote jusqu’au 15 janvier inclus. Plus ça va, plus on nous empêche de travailler librement. Nous perdons de la liberté d’action. Cela ne va pas dans le bon sens », juge-t-elle avant de poursuivre : « Nous sommes des professionnels. Nous suivons des formations. Et pourtant, nous ne sommes pas libres d’exercer notre profession ».







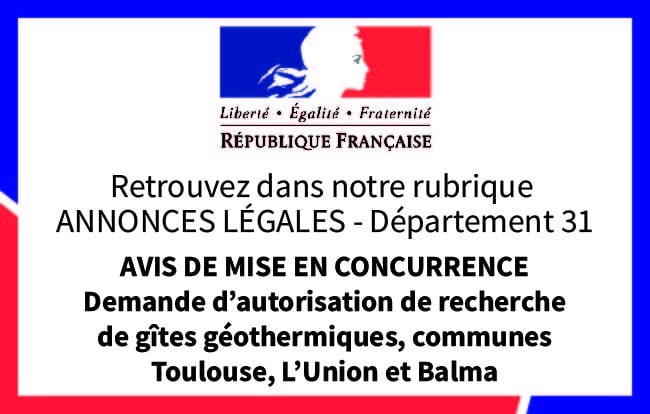

Commentaires