Changement climatique : le village de Moulis, en Ariège, attire des chercheurs du monde entier
9 novembre 2023 - 20:41
Le village de Moulis, en Ariège, peut se targuer d’avoir sur son territoire un centre scientifique d’excellence qui étudie l’impact du changement climatique sur la biodiversité. Unique au monde, il accueille des chercheurs venus des quatre coins du globe.

À Moulis, petit village d’un peu plus de 700 âmes niché dans les Pyrénées ariégeoises, se trouve la Station d’écologie théorique et expérimentale (SETE), un centre scientifique unique en son genre. « Nous faisons un peu école », note Olivier Guillaume, ingénieur de recherche à la SETE. Cette unité de recherche du CNRS étudie la réponse des espèces animales, notamment des poissons, lézards et oiseaux, et végétales au réchauffement climatique. Et ce, comme son nom l’indique, en utilisant des approches théoriques, à l’aide de modèles mathématiques prédictifs, et expérimentales, c’est-à-dire en laboratoire. La SETE a d’ores et déjà pu confirmer l’impact de l’augmentation des températures sur les écosystèmes et organismes.
« C’était une observation déjà faite depuis des dizaines d’années sur les habitats naturels. Mais par l’approche expérimentale, nous pouvons démontrer que les processus observés dans la nature sont bien liés à l’augmentation des températures. Nous pouvons effectivement isoler ce facteur, par rapport à d’autres qui pourraient influencer la réponse des systèmes et des organismes », explique Olivier Guillaume. Pour cela, la SETE dispose d’équipements expérimentaux de pointe, dont 520 m2 de volières, un métatron terrestre, installé sur 4 hectares ce dispositif sophistiqué se compose de 48 cages à population, et un autre aquatique. « Nous pouvons notamment faire varier la température dans les dispositifs pour étudier les scénarios de réchauffement climatique », indique Olivier Guillaume.
Un changement climatique fatal pour certains animaux
Dans le métatron terrestre, les scientifiques de la station d’écologie théorique et expérimentale ont ainsi pu observer les différentes réactions des lézards face au changement climatique. Et les résultats de leurs études sont assez suprenants. « L’augmentation des températures sur les premières années de vie des lézards semble être plutôt favorable puisque nous avons noté une croissance beaucoup plus rapide, une acquisition de la maturité sexuelle plus précoce et également un accouplement qui survient plus tôt dans l’année. Nous avons donc plus de reproduction. Par contre, nous observons un épuisement physiologique chez les lézards caractérisé par une diminution de la longévité, jusqu’à deux ans de moins sur une durée de vie de sept ans », détaille l’ingénieur de recherches.
Il ajoute : « À l’heure actuelle, les modèles prédictifs semblent indiquer que la diminution de la longévité n’est pas compensée par l’augmentation de la fécondité. Nous devrions donc avoir une extinction des populations de lézards soumises aux aires géographiques les plus chaudes et les plus sèches ». Et il ne suffit que de quelques degrés en plus pour faire ce constat. Les scientifiques font varier, selon leurs études, la température entre 0 et +4°C dans les métatrons, et s’efforcent d’être fidèles à la réalité. « Nous avons un degré de réalisme intégré dans nos approches et donc des conditions climatiques avec variations naturelles. Cela comprend des épisodes extrêmes, comme des canicules, mais nous pouvons aussi avoir des épisodes plus froids l’hiver », précise Olivier Guillaume.
Une station qui attire des chercheurs du monde entier
Forcément, la SETE attire des scientifiques, notamment de renom et du monde entier. À commencer par Camille Parmesan, écologue américaine qui a partagé le prix Nobel de la paix en 2007 avec les membres du GIEC et qui dirige l’équipe des scientifiques de la Station. En tout, la SETE accueille en permanence une soixantaine de personnes, dont des chercheurs et techniciens. Mais des doctorants et post-doctorants rejoignent cette équipe du printemps à l’automne. « Nous leur ouvrons nos dispositifs sur projets », informe l’ingénieur de recherches. Si aujourd’hui la Station d’écologie théorique et expérimentale est prisée des écologues, cela n’a pas toujours été le cas. En effet, à la place de la SETE, se trouvait avant un laboratoire souterrain. Créé en 1948, il permettait d’étudier les aspects physiques et biologiques des grottes souterraines.
Puis, Jean Clobert, un directeur de recherches du CNRS, l’a reconverti en Station d’écologie expérimentale en 2007. « La thématique souterraine était en désintérêt au niveau de la communauté. Jean Clobert a donc décidé de faire aller le laboratoire dans une autre direction, plus en phase avec les enjeux écologiques et avec l’idée de développer une approche expérimentale qui n’existait pas », raconte l’ingénieur de recherches. Et le centre scientifique, qui est devenu l’actuelle Station d’écologie théorique et expérimentale en 2016, compte bien rester précurseur dans cette approche. « Il y a un projet de création d’un dispositif spécialement adapté aux microorganismes qui permettrait de démultiplier nos possibilités actuelles de travail », annonce Olivier Guillaume. La SETE n’a donc pas fini de façonner le paysage scientifique de demain.




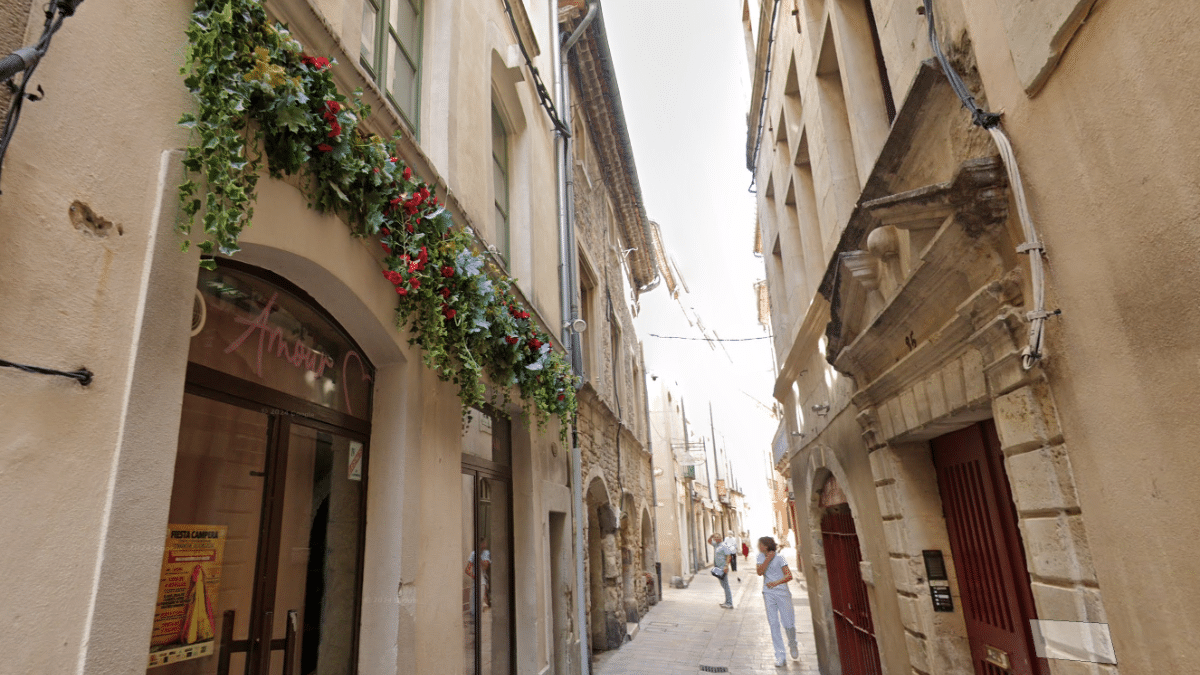




Commentaires
Pierre Seille le 10/04/2025 à 21:23
Intéressant