Vins, cassoulet et pâté : quels rôles jouent encore les confréries en Occitanie ?
1 mars 2023 - 18:08
L’Occitanie compte encore aujourd’hui une centaine de confréries qui œuvrent ardemment pour la sauvegarde des traditions et la défense des produits du terroir. Cette lutte en faveur de la culture locale passe par l’organisation d’événements, l’intronisation de nouveaux membres et la transmission, parfois difficile, des valeurs et des savoir-faire d’autrefois.

Les Chevaliers de la glutte, la Confrérie de la tarte géante aux fraises, l’Ordre de la boisson et de la stricte observance, la Confrérie du petit pâté de Pézenas… Ces associations, tout droit venues d’un autre siècle, font généralement sourire de par leur nom et leurs traditions. Mais leur rôle, lui, est pourtant loin d’être superficiel.
L’Occitanie compte encore aujourd’hui une centaine de confréries réparties au sein de deux académies distinctes, l’une dans l’ex-Languedoc Roussillon, l’autre dans l’ex-Midi-Pyrénées. Leurs missions ? « Défendre le patrimoine œno-gastronomique et mettre en valeur les produits du terroir », résume Jean-Claude Estirach, grand maître de la Commende majeure de Roussillon et doyen de l’Académie des confréries du Languedoc-Roussillon.
Des confréries culturelles et religieuses moins présentes
Il existe des confréries chargées de défendre le patrimoine culturel et religieux de la région. À l’image du Docte collège des consuls de Nîmes ou de la Confrérie du Saint-Christ d’Agde. Mais elles sont minoritaires. En Occitanie, les plus visibles œuvrent pour la sauvegarde des vins et des spécialités locales. « Nous organisons fréquemment des événements en lien avec l’œno-gastronomie. Tandis que les confréries religieuses sont présentes une à deux fois par an, durant les processions par exemple. C’est pour cela qu’on en parle moins, mais ce n’est pas pour autant qu’elles n’existent pas », insiste Jean-Claude Estirach.
Toutes ont, en tout cas, un point commun : la perpétuation des valeurs et des savoir-faire de nos ancêtres. En effet, la notion de transmission est très importante pour les consœurs et les confrères. Prenons l’exemple du cassoulet de Castelnaudary, défendu par l’une des plus grandes confréries de France, dont « l’objectif principal est de sauvegarder la recette originelle de ce plat typique, en la transmettant de génération en génération », poursuit le doyen.
Un moyen de communication au service de la tradition
La confrérie “souveraine et jubilatoire” de la carotte de Blagnac, la confrérie des Capitouls et des “fins” gosiers de Limoux… « Oui, ces noms sont un peu pompeux », rit Éliane Imbert, grand maître de l’Ordre de la poule farcie du Tarn-et-Garonne et doyenne de l’Académie des confréries de Midi-Pyrénées. Mais ils sont, eux aussi, issus d’une tradition datant du Moyen Âge. « Le concept de confrérie, effacé pendant la Révolution, a été remis au goût du jour dans les années 60, par des personnes qui ont conservé le dialecte d’autrefois. Ça fait partie du truc, il ne faut pas en changer », raconte Jean-Claude Estirach.

À cela s’ajoutent des blasons et des tenues propres aux confréries, reprenant des emblèmes et des couleurs rattachées aux produits qu’elles défendent. À l’image des grappes de raisin et du bordeaux pour les confréries bachiques. Chaque association possède également une devise, comme “l’Homme distingué porte le chapeau”, pour les Mousquetaires du Razès, dans l’Aude. « Il vient d’un autre temps, mais c’est un moyen de communication comme un autre », affirme Jean-Claude Estirach, conscient que ces signes d’appartenance marquent facilement les esprits. Et on peut dire que ces symboles font la fierté des confréries. Ils ne doivent pas être pris à la légère. « Un jour, les membres d’une soi-disant confrérie sont arrivés vêtus d’un drap blanc, sans rien en dessous. Je peux vous dire que ces gai-lurons sont venus une seule fois, pas deux », assène le doyen.
La “belle vitrine” des intronisations
Quasiment chaque week-end, les confréries organisent tour à tour des “chapitres”. Ces cérémonies ont pour objectif de créer du lien entre les confrères, tout en dégustant les spécialités du terroir, bien sûr. Mais aussi, d’introniser de nouveaux membres. Il y a quelques jours, même le prince Albert II de Monaco a été intronisé, à titre honorifique, par la Commanderie des maîtres vignerons du Frontonnais à l’occasion de la fête de la Saint-Vincent.
« Il est venu d’un autre temps, mais c’est un moyen de communication comme un autre » Jean-Claude Estirach, doyen de l’Académie des confréries du Languedoc-Roussillon
Ces « coups de com’ » se produisent fréquemment. Ils sont « une belle vitrine » et donnent de la visibilité aux confréries, selon Jean-Claude Estirach. Mais attention, les chapitres sont organisés selon des règles strictes, auxquelles le doyen ne transige pas. « Le nouveau membre doit d’abord déguster le produit qu’il défend, puis prête serment, selon un protocole défini. On passe toujours un bon moment, mais ce n’est pas non plus le carnaval », insiste-t-il.
Des rencontres qui favorisent les débats
Grâce aux cotisations de leurs adhérents, qui s’élèvent généralement entre « 15 et 70 euros par an », selon Éliane Imbert, les confréries organisent également des événements grand public. La Confrérie de la tarte géante ô fraises, par exemple, concocte chaque année une tarte aux fraises XXL dans la commune de Lapeyrouse-Fossat, en Haute-Garonne. « La fête de l’ail à Lautrec, aussi, est toujours un grand moment », sourit le doyen de l’académie du Languedoc.
Ces grandes fêtes réunissent des centaines de personnes autour de vins et de plats traditionnels. Mais elles sont aussi une occasion de se rencontrer, d’échanger autour de sujets sociétaux et environnementaux majeurs. « Les confrères représentent la quasi-totalité des corps de métier. C’est une chance de pouvoir se réunir pour réfléchir ensemble à des solutions à mettre en place dans certains secteurs. En ce moment, beaucoup de questions se posent sur l’avenir de l’agriculture. Pendant nos événements, les professionnels partagent leurs expériences et s’entraident. C’est aussi ça, l’esprit fraternel », juge le grand maître.
Un phénomène passé de mode ?
« Nous avons chaque année une ou deux confréries qui cessent leurs activités. Mais il y en a aussi qui se créent. D’ailleurs, nous sommes en train d’en monter une à Amélie-les-Bains, dans les Pyrénées-Orientales, qui sera chargée de défendre la rousquille catalane », expose Jean-Claude Estirach. Dans l’ex-Midi-Pyrénées, aussi, « nous avons récemment vu naître la Confrérie de la marquisette », complète Éliane Imbert. Et même de l’autre côté de l’Atlantique : « nous avons fondé la première confrérie de Guyane il y a deux ans, pour défendre le bouillon d’awara », ajoute Jean-Claude Estirach, aussi élu au niveau européen, en tant que vice-président, pour la France, du Conseil européen des confréries oenogastronomiques (CEUCO).
Toutefois, les confréries ont bien du mal à séduire les nouvelles générations. « Nous essayons de trouver des solutions pour donner envie aux jeunes de s’engager, mais c’est compliqué. Ils manquent souvent de temps pour participer aux chapitres les week-ends, par exemple. Mais il faudra bien un jour que nous changions de modèle, que nous allions vers de la nouveauté. Car ce n’est pas entre “vieux” que nous allons perdurer. Toutefois, je garde espoir qu’un jour les jeunes se rendent compte de l’importance de nos actions, tant dans la transmission des traditions que dans la défense du terroir, qui rejoint les enjeux environnementaux auxquels ils sont attachés », termine le doyen des confréries du Languedoc.





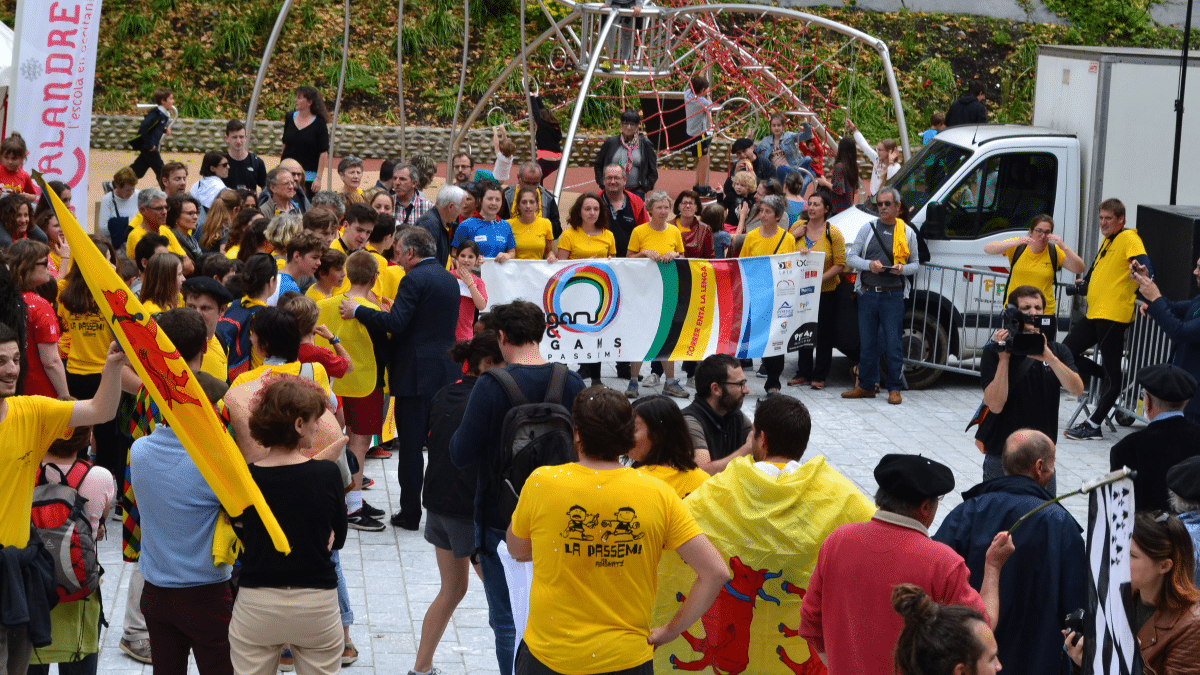



Commentaires