Toulouse : Le livre témoignage des rescapés de l’attentat de l’école Ozar Hatorah
16 mars 2022 - 17:35
10 ans après l’attentat perpétré par Mohamed Merah à l’école juive Ozar Hatorah de Toulouse, Jonathan Chetrit, un ancien élève, présent le jour de la tuerie, publie un livre intitulé “Toulouse, 19 mars 2012” (Editions Albin Michel). Un ouvrage poignant dans lequel l’auteur a recueilli les témoignages, minute par minute, des élèves et personnels enseignants ayant vécu le drame de l’intérieur. Il revient, pour le Journal Toulousain sur cet événement qui marquera le reste de sa vie.

Jonathan Chetrit, vous venez de publier “Toulouse, 19 mars 2012“, aux Editions Albin Michel. Pourquoi avoir attendu 10 ans?
Le travail de recueil a commencé il y a deux ans. Mais il n’aurait pas pu avoir lieu plus tôt. Le temps nécessaire aux élèves qui témoignent dans cet ouvrage de prendre du recul, de pouvoir aborder le sujet, de pouvoir revivre précisément cette scène, de réussir à mettre des mots sur ce traumatisme. Si je les avais sollicités il y a cinq ans, j’aurai essuyé beaucoup de refus.
Qu’est-ce qui vous a décidé à publier ce livre témoignage?
Pour ma part, j’ai eu besoin d’écrire très tôt. J’avais donc déjà rédigé plusieurs textes, mais je ne savais pas comment les articuler ni comment présenter les événements. Et j’ai eu un déclic lors du confinement. J’avais alors du temps et les élèves prêts à témoigner aussi. J’ai eu le sentiment que s’il me fallait produire quelque chose, c’était maintenant ou jamais. J’ai donc profité de cet isolement forcé pour recueillir leurs paroles.
Une blessure béante qui unit les rescapés
Votre livre se présente ainsi sous la forme d’un recueil de témoignages qui s’enchaînent, se répondent, au fil des heures de ce 19 mars 2012. Pourquoi ce choix, plus que celui d’un récit des faits?
Quand j’ai commencé à écrire mon récit, de mon côté, j’ai immédiatement pressenti qu’il manquait quelque chose. Pour que le rendu final soit complet, il fallait que chacun puisse raconter ce qu’il avait vécu. D’autant que, étant encore très proches, je savais que mes camarades avaient perçu ces événements d’une manière différente. Tous ont joué un rôle ce 19 mars 2012, de l’intérieur ou de l’extérieur. Ainsi, dans le livre, les angles de vue sont nombreux et complémentaires. Beaucoup n’avaient jamais eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet, de raconter comment ils avaient vécu ce drame. Et c’était aussi une façon de leur rendre hommage.
Quant à la structure du livre, elle s’est mise en place assez naturellement, par tranche horaire. Je connaissais les instants déterminants, et je me rappelais précisément ce qu’il s’est passé et ce que j’ai ressenti à ces moments clés. Mes camarades aussi. Multiplier les différents témoignages à une même heure m’a ainsi permis de guider les autres dans leur récit.
Comment ont réagi les personnes que vous avez contacté pour témoigner? Tous ont accepté?
J’ai obtenu un “oui” très rapidement de la plupart d’entre eux. Pour la majorité, je n’ai même pas eu à les convaincre en réalité, car j’ai commencé par poster un message sur un groupe Facebook d’anciens élèves de l’école Ozar Hatorah. J’y ai expliqué mon intention et lancé un appel à témoin. Et ce sont eux, les protagonistes de mon livre, qui m’ont contacté.
J’ai quand même essuyé quelques refus, notamment des Sandler et des Monsonégo (familles des quatre victimes, NDLR). Ils m’ont soutenu dans ma démarche, mais cela s’est avéré trop difficile pour eux de revenir sur cette tragédie, même 10 ans après. De même, Bryan Bijaoui, qui a été blessé par balle ce matin-là, m’a répondu avoir besoin d’exister au travers d’autre chose que cet attentat. Sa reconstruction s’effectue loin de tout cela et je le respecte. D’autres anciens élèves ont également refusé de participer au projet parce qu’il leur était trop difficile de se remémorer cette tuerie.
“Un simple regard suffit pour que nous comprenions que l’un d’entre nous a besoin de parler”
10 ans après, vos camarades et vous, parlez-vous plus facilement de cet attentat?
Entre nous, qui avons vécu les mêmes événements, il s’agit d’une réelle force, qui nous a permis de nous reconstruire. Nous abordons le sujet très facilement. D’ailleurs, souvent, un simple regard suffit pour que nous comprenions que l’un d’entre nous a besoin de parler. Et parfois, nos regards en disent plus long que les propos que nous pourrions tenir.
En revanche, coucher tous nos souvenirs et nos ressentis sur du papier, et en faire un livre, c’était différent. Nous savions qu’il ne resterait pas entre nous, que tout le monde pourrait s’en emparer… y compris les médias. Nombre de mes camarades ont été sollicités par la presse pour raconter, encore, leur histoire et n’ont pas souhaité répondre. Ils restent sur la mauvaise expérience du 19 mars 2012, où les journalistes s’étaient massés devant notre école.
Retour sur un traumatisme
Dans votre livre, vous évoquez des séquelles encore aujourd’hui…
Elles sont très concrètes. Me retrouver dans un grand rassemblement, au milieu de la foule, me demande un effort, un réel travail psychologique. De même, lorsque je suis dans un endroit clos, je cherche les issues de secours, j’ai besoin de savoir comment je pourrai sortir s’il arrivait quelque chose. Et je m’aperçois que, inconsciemment, j’y pense tout le temps. Même, quand je vais dans un bar ou un restaurant, j’essaie d’avoir une vue sur l’entrée pour voir qui passe la porte.
Au-delà de ces considérations, je garde le traumatisme d’avoir perdu des personnes qui comptait pour moi à savoir Jonathan, Arié et Gabriel Sandler ainsi que Myriam Monsonégo. Quand je passe du temps avec mes neveux, je pense systématiquement à eux.
Ce 19 mars 2012, Mohamed Merah faisait donc irruption dans votre école et tuait quatre personnes, dont trois enfants. Dans votre ouvrage, vous avez compilé les différentes manières dont chaque témoin de la scène a vécu ce traumatisme. Est-ce un besoin d’expliquer à ceux qui n’étaient pas présent ?
Dans les premiers moments qui ont suivi l’attaque, et encore aujourd’hui, mes camarades et moi avons eu le sentiment que ceux qui ne l’avaient pas vécu ne pouvaient pas comprendre. Ainsi, beaucoup se sont réfugiés dans le mutisme, estimant que cela ne servait à rien d’expliquer. D’abord parce qu’il était difficile de mettre des mots sur notre détresse. Ensuite, parce que nous pensions que personne ne pouvait en saisir l’ampleur. Dans les heures et les jours qui ont suivi l’attentat, nous étions tellement choqués que nous-mêmes ne réalisions pas vraiment ce qu’il venait de se passer.
Et j’ai l’impression que ce livre permettra à tout ceux qui n’étaient pas là, de mieux comprendre ce que nous avons vécu. D’ailleurs, de nombreuses personnes, qui pourtant me connaissent bien, disent prendre aujourd’hui la mesure de la violence des faits et de l’impact qu’ils ont pu avoir sur moi. Malgré tout, je ne peux m’empêcher de penser qu’il faut l’avoir vécu pour comprendre réellement.

A la lecture du livre, on constate que vous et vos camarades avez des souvenirs précis des faits, mais aussi des sentiments que vous avez pu éprouver…
Pour ma part, j’avais déjà mis par écrit de nombreux éléments. Ce qui m’a permis de les reprendre ensuite dans le livre, de manière très précise. Mais effectivement, même 10 ans après, je me souviens de détails extrêmement pointus, comme la météo par exemple. Cette journée nous a tellement marqués, que nous nous rappelons tous de l’état dans lequel nous nous trouvions, de nos émotions qui se succédaient, du désarroi au déni en passant par la peine immense. Et même, de ce temps de latence durant lequel nous ne réalisions pas…
Justement, à quel moment avez-vous réalisé ce qu’il venait de se passer?
J’ai pris une première claque quand je suis sorti dans la cour de l’école. Je me suis retrouvé propulsé sur une scène de crime, avec du sang au sol et des corps recouverts. Ce moment-là m’a permis de réaliser la gravité de ce qu’il venait se passer. La seconde s’est produite à ma sortie de l’établissement, quand je devais faire attention à ne pas poser mes pieds dans les flaques de sang. La dernière étant la veillée, le soir même de la tuerie, lorsque je me trouvais auprès des corps. Là, j’avais totalement compris que je ne rêvais pas. Et malgré tout, je me rappelle espérer de toute mes forces que tout cela n’était qu’un mauvais cauchemar, et que j’allais me réveiller.
Dans les yeux d’un enfant
Et parallèlement au processus de deuil qui se mettait en place à l’école Ozar Hatorah, avait lieu la traque de Mohamed Merah, l’auteur de cet attentat. Vous ne vous y attardez pas dans votre ouvrage. Comment l’avez-vous vécu?
Pendant trois jours, nous ressemblions à des zombies. Nous dormions très peu, un peu hagards, et nous n’avions qu’une envie, celle de rester ensemble. Mes camarades de classe et moi nous sommes alors réfugiés chez une amie. Nous y suivions la traque à la télévision, car nous voulions que ce terroriste soit retrouvé. Nous n’attendions pas forcément une fin spécifique à cette chasse à l’homme, mais nous souhaitions savoir qui il était. C’était important pour nous de pouvoir mettre un nom, un visage sur l’homme qui est entré dans notre école, et nous a arraché des gens que nous aimions. Toutefois, notre n’étions pas focalisé dessus, car, en même temps, avait lieu l’enterrement d’Arié, Gabriel, Myriam et Jonathan en Israël, que nous regardions sur Internet. Du coup, ces instants-là restent très confus.
“C’est des années après que nous avons mesuré l’impact que tout cela aurait sur nos vies”
Comment gère-t-on un tel traumatisme à seulement 17 ans?
J’avais beau croire que j’étais adulte et mature à 17 ans, je n’étais qu’un enfant. Nous n’étions que des enfants. Et ce drame a certainement perturbé notre développement, notre construction. Mais, finalement, c’était tellement brutal et nous étions tellement jeunes, que nous avons d’abord géré l’instant, la priorité était de se relever, vite : comment parvenir à redormir sereinement, comment retourner à l’école sans appréhension… Ce n’est que plus tard que nous avons fait face à nos traumatismes. La prise de conscience s’est faite avec le temps, en grandissant. C’est des années après que nous avons mesuré l’impact que tout cela aurait sur nos vies.
“Vous relever vite”. D’autant que quelques mois plus tard, vous passiez votre Baccalauréat…
Il y a eu trois mois entre la tuerie et l’examen. Nous avons eu la chance d’avoir des enseignants qui ont su nous protéger, tout en nous préparant à cette échéance. Ils ont été admirables. D’abord parce que, eux aussi, ont été très choqués et sont pourtant revenus à l’école pour soutenir les élèves. Ensuite, parce qu’ils ont eu la finesse et la délicatesse de comprendre quand l’un d’entre nous ne se sentait pas bien. Il leur arrivait d’arrêter les cours quand cela devenait trop oppressant. Ou, au contraire, de nous pousser à réviser. Et tout le monde a eu son Baccalauréat.
Une reconstruction, loin de Toulouse
Viennent alors les études universitaires. Et vous avez choisi de quitter Toulouse rapidement…
Originaire de Paris, j’étais interne à l’école Ozar Hatorah depuis cinq ans. Et, avant le drame, je m’interrogeais déjà sur l’endroit où je poursuivrais mes études. Mais je n’avais pas pris ma décision. En 2012, j’ai compris qu’il fallait que je rentre, que j’avais besoin d’être proche de ma famille. Je suis reparti à Paris sans hésiter.
Avez-vous gardé contact avec vos camarades de lycée?
Évidemment! On est en contact de façon très régulière, quotidienne pour certains, par tous les canaux de communication possible. Il s’agit d’un lien indéfectible. D’autant que l’école a pris l’initiative d’organiser des retrouvailles annuellement. Et chaque 19 mars, nous sommes nombreux à revenir à Toulouse. C’est un besoin pour ma part !
Cinq ans après le drame, en 2017, un premier procès s’est ouvert. Puis un second, en 2019. Vous avez assisté à l’intégralité des audiences. Etait-ce nécessaire à votre reconstruction?
Je voulais comprendre. D’abord comprendre les faits, pour obtenir des réponses claires suite aux différentes versions qui avaient été avancées. Ensuite, comprendre comment un garçon de 24 ans peut en arriver à de telles extrémités. On a souvent évoqué un “loup solitaire” alors qu’il faisait partie d’une organisation bien rodée. Je ne crois pas du tout à cette théorie, il était loin d’être isolé, comme cela a été démontré lors des procès. Son frère, notamment, l’a aidé. Ce dernier, qui a joué un rôle déterminant dans l’attentat, est profondément mauvais et haineux. Il n’a pas émis de regrets lors de la procédure judiciaire, il n’a pas demandé pardon et a affirmé ne pas vouloir se soumettre aux lois de la République française. Il ne connaissait même pas le nom des victimes.
Au verdict final, vous écrivez: “C’est fini. Pour de bon. C’est fini.” De quoi parlez-vous exactement?
De toute cette période juridique qui a été intense. D’autant que j’étais très impliqué. Assistant à toutes les audiences, j’en faisais le résumé à mes camarades qui ne pouvaient pas être présents. Cela m’a demandé beaucoup de force, d’énergie et de courage. L’ambiance était anxiogène. C’était lourd, pesant. Et au verdict, tout cela s’est arrêté. Plus d’incertitudes, de questions, plus de doutes. Enfin!
Devoir de mémoire

10 après l’attentat, quel est votre sentiment?
Je n’ai jamais ressenti de colère, de haine ou une quelconque volonté de revanche. Mais, même 10 ans après, j’éprouve toujours beaucoup de peine et de douleur. C’est le sentiment principal. J’ai appris à vivre avec. Désormais, je n’y pense plus constamment. Et heureusement! J’ai ainsi pu me reconstruire. Pourtant, régulièrement, un détail vient me rappeler qu’Arié, Gabriel, Myriam et Jonathan ne sont plus là.
Est-ce que ce drame a eu un impact sur votre rapport avec la religion?
Cet événement a éveillé en moi des questions : Si Dieu existe, comment a-t-il pu permettre une telle horreur? Et j’ai observé le directeur de l’école et son épouse qui ont perdu leur fille dans l’attentat, ainsi qu’Éva Sandler qui elle a perdu deux de ses enfants et son mari. La façon dont ils se sont relevés de cette épreuve, dans la foi, avec courage et dignité, m’a servi d’exemple. Ils m’ont permis de balayer mes interrogations. Au final, ma foi s’est renforcée.
Vous dites en préambule du livre : “Lisez, comprenez, transmettez”. C’est ce à quoi vous exhortez les lecteurs ?
Tout à fait. C’est mon seul et unique but aujourd’hui: le devoir de mémoire. Prenez le temps de comprendre, écoutez ou lisez le récit de ceux qui l’ont vécu et transmettez pour ne plus que ce genre d’horreur ne se reproduise.
Toulouse, le 19 mars 2012, collège Ozar Hatorah, à l’heure où les élèves arrivent en cours. Un motard casqué fait irruption dans la cour et sème la mort, tuant à bout portant un enseignant, Jonathan Sandler, et trois jeunes enfants : Arié (5 ans) et Gabriel Sandler (3 ans) et Myriam Monsonégo (9 ans), la fille du directeur.
Ce crime a initié la série d’attentats islamistes qui ont endeuillé le pays de 2012 à 2015. Son traitement médiatique s’est focalisé sur la personnalité et la famille du tueur, Mohamed Merah. Les victimes ont certes suscité la compassion, mais on n’a peut-être pas pris la pleine mesure de l’inhumanité que représente cet événement – pour la première fois en France depuis l’Occupation on a tué de sang-froid des juifs uniquement parce qu’ils sont juifs. Un récit brut, violent par sa sobriété même, qui n’a pas d’équivalent.
“Toulouse, 19 mars 2012”. L’attentat de l’école Ozar Hatorah par ceux qui l’ont vécu
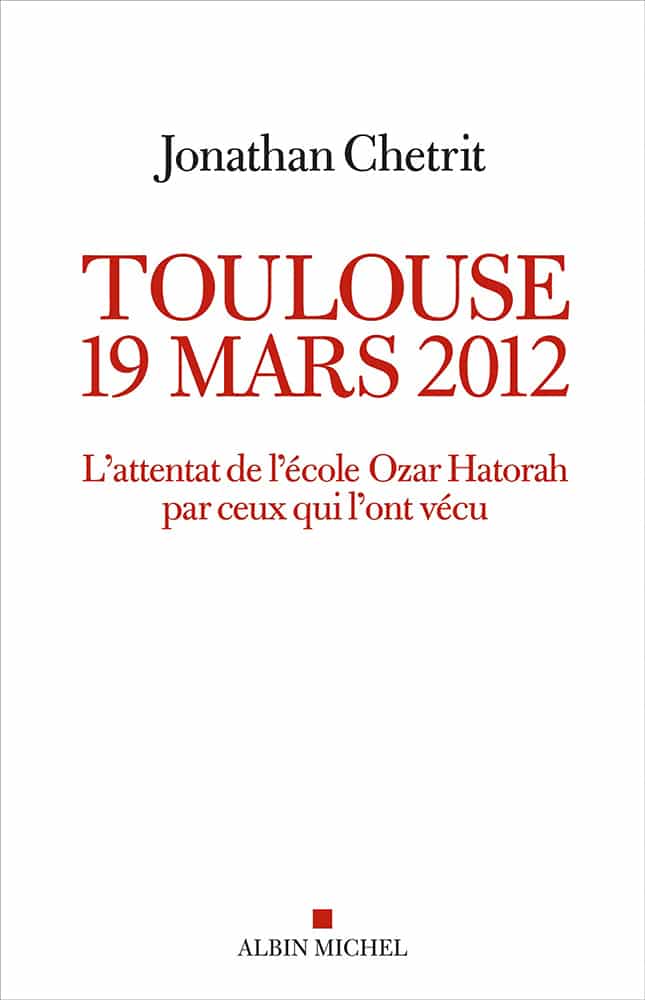
Jonathan Chétrit qui, en tant qu’élève interne présent sur place, a vécu les meurtres au plus près, a collecté les témoignages minute par minute de toutes les personnes présentes. Il nous fait entrer dans la réalité brutale de ces instants fatidiques, et de ce qui a suivi pour les survivants : la ruée des journalistes, le deuil impossible, mais aussi la solidarité, la volonté de se battre, jusqu’au procès des complices.








Commentaires