[Grande interview] Pour l’Union régionale des Scop, la coopérative est un modèle d’avenir
2 mars 2022 - 15:56
6 000 emplois, 660 millions d’euros de chiffre d’affaires répartis entre 419 sociétés, les sociétés coopératives (Scop et SCIC) se portent bien Occitanie. En 2021, l’Union Régionale des Scop Occitanie Pyrénées a accompagné la création de 28 entreprises sous ce statut (21 en 2020). De quoi rendre confiant Cyrille Rocher, directeur du pôle Pyrénées de l’Union régionale des sociétés coopératives (Urscop) Occitanie qui évoque pour le Journal Toulousain les perspectives de ce modèle de gouvernance.

Cyrille Rocher, avec une croissance de 10 % des effectifs de salariés en 2021, les coopératives semblent se porter bien en Occitanie. Confirmez-vous ces bons résultats ?
Malgré un contexte toujours marqué par la crise sanitaire, 2021 reste une belle année, très satisfaisante. Nous avons accompagné des projets de qualité avec, notamment, plusieurs rachats d’entreprises par les salariés. Aujourd’hui, les dirigeants envisagent plus facilement de transmettre l’entreprise à leurs salariés, quand ils souhaitent cesser leur activité. Ce changement de mentalités ouvre la voie à de belles reprises.
La transmission d’entreprise est un moment privilégié pour créer une Scop ?
Le passage en coopérative lors d’un départ à la retraite programmé, par exemple, permet un rachat par les salariés de sociétés dites ‘’in bonis’’ (une société financièrement saine qui ne soit pas sous le coup d’une procédure collective, NDLR). En 2021, 7 rachats sur 8 au sein du pôle Pyrénées de l’Urscop Occitanie se sont faits dans ce cadre et ont permis le maintien de 130 emplois.
« Notre but est que chaque projet de coopérative soit une bonne nouvelle pour les salariés »
De même, le passage en Scop est fréquemment envisagé par des salariés qui veulent sauver leur emploi quand leur entreprise se trouve dans une relation judiciaire (redressement, liquidation, etc.). Mais cette motivation, plus émotionnelle que rationnelle, est rarement suffisante. En effet, dans 9 cas sur 10, ce rachat n’est pas viable, car les difficultés de l’entreprise sont des conséquences directes du modèle économique. Dans ce cas, nous déconseillons la solution coopérative, car notre but, à l’Urscop, n’est pas de lancer des coopératives pour lancer des coopératives, mais que chaque rachat soit une bonne nouvelle pour les salariés.
Quels sont les avantages du modèle coopératif ?
Une coopérative est une entreprise qui, au lieu d’être détenu par des propriétaires décideurs, est partagée par l’ensemble de ses salariés. Ce modèle n’est pas bien ou mal en soi, mais il permet d’instaurer une gouvernance qui permet de proposer un autre modèle au sein de l’entreprise et de répondre aux attentes citoyennes des salariés. La quête de sens au travail est, aujourd’hui, un critère d’investissement professionnel essentiel pour les jeunes. Pour que cela fonctionne, il faut que les choix de l’entreprise correspondent aux attentes citoyennes des salariés.
Par ailleurs, les sociétés coopératives, comme elles ne peuvent pas être vendues, permettent de pérenniser l’emploi et les savoir-faire sur un territoire. En effet, une Scop qui a été créée à Millau restera à Millau. Celle-ci ne pourra jamais être cédée à un investisseur qui délocaliserait dans une autre région ou un pays où les coûts de production pourraient être inférieurs. Enfin, les Scop ont démontré leur forte résilience en période de crise.
Le modèle coopératif peut-il s’avérer un frein à la compétitivité ?
Absolument pas. Malgré ses caractéristiques particulières, notamment de gouvernance et de répartition des bénéfices, une Scop reste une entreprise avec ses exigences économiques. Et, au contraire, le cadre qui impose, en plus d’une répartition équitable entre salariés et salariés-associés, de réinvestir une part des bénéfices va dans le sens de garantir des entreprises performantes et pérennes. On ne peut pas plumer la boîte.
« Il n’y aura pas de coopératives qui fabriqueront des armes ou des munitions »
Est-ce que ce modèle est adaptable à tous les secteurs d’activité ?
Oui, le modèle de la Scop peut s’adapter à tous les secteurs : industriels, services, commerces, agricoles, etc. Mais si les Scop peuvent recouvrir un large champ d’activité, nous restons très regardants sur certains secteurs, notamment ceux qui impliquent des activités polluantes. Les Scop sont des entreprises qui ont du sens et qui promeuvent une alternative. Par exemple, il n’y aura pas de coopératives qui fabriqueront des armes ou des munitions.
En définitive, l’engagement en coopérative s’inscrit dans une démarche responsable. C’est un modèle qui convient très bien aux entreprises qui s’engagent dans la transition et la quête de solutions aux grands enjeux sociétaux et environnementaux.
Le modèle coopératif a-t-il encore une grande marge de développement ?
Oui. Selon un sondage OpinionWay, 74 % des dirigeants d’entreprise estiment que c’est un modèle d’avenir et 77 % des salariés voudraient travailler dans une Scop au cours de leur carrière. Enfin, 27 % des dirigeants se disent prêts à vendre leur société aux salariés au moment de la transmission de leur activité. D’ailleurs, sur ces cinq dernières années, nous avons connu une hausse de 32,3 % du nombre de Scop et SCIC.
« Les gens ne voient plus les coopératives comme un modèle de revanche sociale développé par des bandes cyrpto-trotskistes »
Comment expliquez-vous cet engouement ?
Les gens commencent à comprendre ce qu’est une coopérative. Nous sortons peu à peu du délit de sale gueule qui voyait les coopératives comme un modèle de revanche sociale développées par des bandes de cryptotrotskistes.
La vraie limite d’une coopérative se trouve dans l’intensité capitalistique de son modèle économique
Y a-t-il une limite, de taille, d’effectif ou de chiffre d’affaires, au développement d’une coopérative ?
Il n’y a pas de difficulté particulière à avoir des coopératives de grande taille. Une société comme Acome (spécialisée dans la production de câbles, NDLR) a été fondée en 1932 sur ce modèle et emploie aujourd’hui plus de 1300 salariés. L’important c’est de trouver un équilibre entre associés et non-associés au moment de prendre des décisions sur le développement de la société.
La vraie limite d’une coopérative se trouve dans l’intensité capitalistique de son modèle économique. C’est-à-dire le volume d’argent nécessaire aux salariés pour acquérir leurs machines, leurs outils de production. Goodyear ou Air France, par exemple, ne seront jamais des Scop. Ce n’est pas financièrement réaliste. Il faut une telle somme de capitaux pour acheter les usines ou toute une flotte d’avions de ligne que c’est impossible à réunir pour les salariés. Or, dans une coopérative, ces derniers doivent posséder, à minima, 51 % du capital de la société.
Pourtant il existe de très grosses coopératives comme Scopelec ou Railcoop ?
Précisément, pour répondre à cet enjeu capitalistique, Railcoop a choisi le modèle de la SCIC qui permet d’intégrer des collectivités locales, des fondations ou des citoyens au capital de la société. Mais, même avec ces outils, Railcoop n’achète que des trains d’occasion et fonctionne, pour tout le reste, avec du leasing (des locations avec option d’achat, NDLR). Pour Scopelec, la plus importante Scop française en termes d’effectifs, la situation est différente. Son activité et son plus gros client, Orange, l’ont poussé à se développer très vite afin de pouvoir réaliser de très grosses interventions. Aujourd’hui, Scopelec dispose d’un navire amiral de 1200 associés-sociétaires et d’une dizaine de sociétés, qui ont été rachetées, mais qui ne sont pas des coopératives.
copelec est surtout victime d’un grave incident industriel
Mais aujourd’hui, Scopelec est en difficulté et il semble y avoir une fracture entre les salariés et la direction.
Scopelec est surtout victime d’un grave incident industriel, avec le non-renouvellement d’un contrat qui représente 40 % du chiffre d’affaires de la société. Mais perdre un marché n’est pas nécessairement le fait d’un problème de gouvernance et ce qui arrive à Scopelec ne remet pas en question le modèle coopératif. Orange, qui n’a pas renouvelé un contrat de 150 millions d’euros n’est pas là pour faire de cadeaux. Ce qui est positif, c’est que les salariés, grâce au modèle de la Scop, peuvent demander des comptes et interroger leur gouvernance pour connaître les raisons qui ont fait perdre ce marché.
Il suffit que 10 % des salariés en fassent la demande pour qu’une assemblée extraordinaire soit réunie, en moins de 15 jours. C’est d’ailleurs ce qui va se passer ce jeudi. Les salariés-sociétaires vont discuter entre eux pour envisager comment surmonter la situation avec une stratégie qui évite la simple suppression des 1200 à 1500 emplois menacés. Le directoire et le conseil de surveillance vont devoir s’expliquer. Et, ça, c’est une bonne chose.





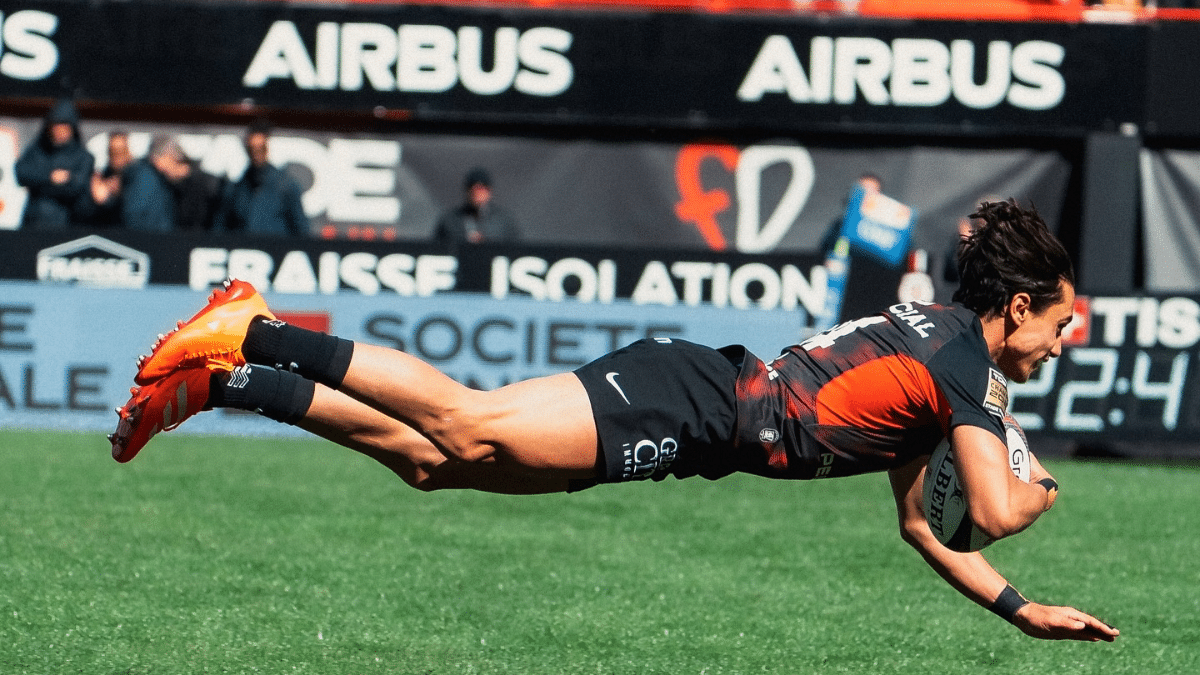


Commentaires