[Conseils d’expert] Les atouts de la donation-partage
29 octobre 2015 - 07:59
La donation-partage consiste à répartir, de son vivant, tout ou partie de ses biens entre ses héritiers présomptifs. Elle réunit la famille autour d’un même acte, ce qui limite le risque de conflits ultérieurs, notamment lors du règlement final de la succession.
La donation-partage permet de gratifier simultanément chacun de ses enfants. S’ils sont mariés, les parents peuvent la consentir ensemble, ce qui est le cas le plus fréquent. Cette donation-partage conjonctive est maintenant ouverte aux familles recomposées. Il est désormais possible d’y associer ses petits-enfants, en « sautant » une génération. C’est la donation-partage transgénérationnelle. Les donations graduelles et résiduelles permettent de transmettre des biens à deux bénéficiaires successifs et en deux temps. Enfin, lors d’un décès, le conjoint survivant peut partager tant ses biens que ceux du défunt. C’est la donation-partage cumulative.
La donation-partage est la voie royale pour anticiper et organiser la transmission de son patrimoine, de manière concertée avec ses enfants. Tous les enfants ou présomptifs héritiers doivent obligatoirement intervenir et être allotis, même si la répartition n’est pas obligatoirement égalitaire. Il est en effet possible de privilégier un ou plusieurs enfants (et sauf convention contraire ou atteinte à la réserve, cette inégalité ne sera pas rattrapée lors du décès). Il est aussi possible d’attribuer des biens de valeur différente aux enfants tout en voulant respecter l’égalité entre eux. L’équilibre sera alors rétabli par le paiement d’une soulte.
L’un de ses principaux avantages est que, sous certaines conditions, les lots reçus par chaque donataire ne seront pas réévalués lors de la succession, même si leur valeur évolue. Nous disons que les valeurs sont « bloquées » au jour de la donation. Au contraire, dans le cas de donations dites « simples », le gratifié devra le « rapport » de la donation qui lui a été consentie selon la valeur du bien donné au jour du décès, disposition source fréquente de conflit. Imaginons qu’une fille reçoive de son père une somme d’argent qu’elle dépense en voyages tandis que son frère reçoit un appartement de même valeur, mais dont la valeur augmente au cours des années suivantes. Avec la donation simple, au décès du père, le fils recevra une part d’héritage plus faible et pourrait même, dans certains cas, être contraint de verser une somme d’argent à sa sœur. Avec la donation-partage, la valeur des biens donnés au jour du partage est retenue lors de la succession : cette difficulté est donc évitée. L’égalité qui existait lors de la donation perdure jusqu’au règlement de la succession et ne peut donc être remise en cause en fonction de l’aléa des évolutions de valeur des biens donnés ou de l’utilisation qui en est faite.
Si des donations ont été antérieurement consenties en la forme « simple », il est possible de leur donner le caractère de « donation-partage » en les réintégrant. Cette opération ne donne pas lieu au paiement de droits de mutation, puisqu’ils ont déjà été réglés, mais est soumise au droit de partage au taux de 2,50%. De plus, en intégrant les donations antérieures à la donation-partage, les parents peuvent « remettre les compteurs à zéro » et rétablir l’égalité entre leurs enfants.
Céline CHWARTZ-LAIR,
Vice-Président de la Chambre Interdépartementale des Notaires de la Cour d’appel de Toulouse.
Coordonnées :
Chambre Interdépartementale des Notaires de Toulouse
51 rue Raymond IV
31000 TOULOUSE
Tél 05 62 73 58 68
La rédaction
Le Journal toulousain est un média de solutions hebdomadaire régional, édité par la Scop News Medias 3.1 qui, à travers un dossier, développe les actualités et initiatives dans la région toulousaine. Il est le premier hebdomadaire à s'être lancé dans le journalisme de solutions en mars 2017.
Voir les publications de l'auteurActualités en continu - Actualités
- Actualités
-
Essonne
Essonne : Une étude sur l’avenir de la gare de Massy-Palaiseau
29 avril 2025 - 10:16
-
Toulouse
Toulouse : début des travaux d’une tour de 18 étages qui va transformer le paysage
24 février 2025 - 19:15
-
Actualités
Vacances de Noël en Andorre : un programme féerique dans les stations de ski
19 décembre 2024 - 18:03
-
Lot-et-Garonne
3 musées gastronomiques du Lot-et-Garonne où s’ouvrir l’appétit
7 décembre 2024 - 15:03
-
Actualités de l'Hérault
Occita’fun, le premier parc de loisirs indoor multi-activités de l’Hérault est lancé
1 décembre 2024 - 18:07
-
Toulouse
Découvrez les meilleurs spots pour voir le feu d’artifice à Toulouse le 13 juillet
29 juin 2024 - 09:02
-
Actualités des Pyrénées-Orientales
Pyrénées-Orientales : 137 communes bénéficieront de nouvelles aides économiques
28 juin 2024 - 20:41
-
Actualités de l'Aveyron
Pourquoi l’Aveyron est médaille d’or des aides agricoles de la PAC
25 avril 2024 - 16:31
-
Culture Gers
Mouss et Hakim du groupe Zebda en tête d’affiche au festival Welcome In Tziganie
23 avril 2024 - 15:26







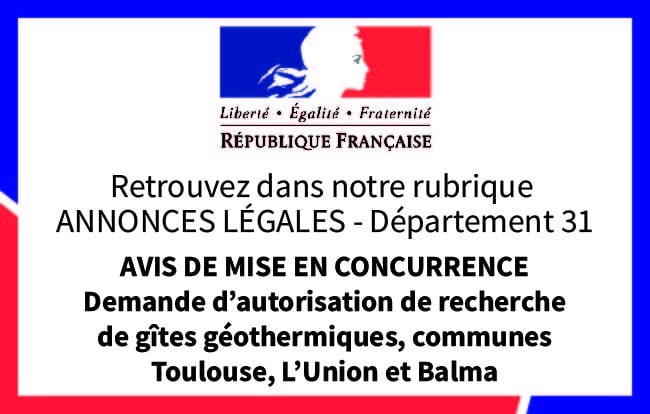

Commentaires