Le collectif Ethique sur les étiquettes déshabille l’industrie textile
11 janvier 2018 - 08:00
DÉTRICOTER. Face à une industrie du textile peu encline à la transparence, difficile pour les consommateurs de mesurer l’impact social de leurs vêtements. Coordinatrice de l’antenne toulousaine du collectif Éthique sur étiquette, Anne-Marie Viguier, estime tout de même qu’en réfléchissant à ses achats, chacun peut peser sur les grandes enseignes présentes en France pour améliorer le sort des ouvriers à l’autre bout de la planète.
Pour que les droits humains au travail soient respectés dans le monde et en particulier ceux des ouvriers de l’industrie textile en Afrique et en Asie, le collectif Éthique sur l’étiquette œuvre depuis 20 ans à la mobilisation de l’opinion française afin de faire pression sur les décideurs économiques et politiques.
Créée en 2010, l’antenne de Toulouse relaie localement les campagnes nationales via des actions de rue. « Nous en organisons notamment chaque année en juin, à la période des soldes. Nous nous postons à proximité des grandes enseignes vestimentaires pour les interpeller mais l’idée est surtout de sensibiliser les consommateurs sur les conditions dans lesquelles sont fabriqués les habits vendus par ces marques », explique Anne-Marie Viguier, sa coordinatrice.
Un travail de fourmi qui porte lentement ses fruits. Surtout depuis le drame du Rana Plaza, l’effondrement d’un bâtiment ayant provoqué la mort de plus de 1000 ouvriers du textile au Bangladesh en 2013. Depuis, quelques enseignes ont élaboré des chartes de responsabilité qu’ils affichent dans leurs boutiques. Mais difficile de s’y fier selon le collectif. « C’est uniquement de l’image. À partir du moment où l’on propose des t-shirts à des prix aussi bas, c’est forcément au détriment d’un maillon de la chaîne, qui est toujours le même, l’ouvrier. En juin 2016, à l’occasion de l’Euro de foot, nous avons réalisé une campagne ciblant les grands équipementiers en démontrant que sur un maillot de foot vendu 90 euros, seulement 60 centimes revenaient à celui qui le fabriquait », raconte Anne-Marie Viguier.
Malgré la prise de conscience des consommateurs, l’industrie du textile manque encore cruellement de transparence. Indiquant uniquement le dernier pays par lequel il est passé, l’étiquette apposée sur un vêtement ne dit par exemple rien de sa véritable origine. Comment alors s’y retrouver dans un secteur où très peu de labels concernent l’aspect social de la fabrication ? « Il y a des blogs et des sites comme sloweare.com pour trouver des informations. Mais on peut aussi réfléchir à sa consommation en achetant moins et de meilleure qualité ou en allant dans des boutiques de seconde main, voire en louant ses vêtements. Sinon, la mention Made in France, est déjà une garantie assez sure. » En tout cas, pour changer les choses tout en maintenant le travail des ouvriers du textile, Éthique sur étiquette ne prône pas le boycott des grosses enseignes mais entend peser sur les donneurs d’ordre situés en France.
En mars 2017, une loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères vis-à-vis de leurs sous-traitants a été adoptée. Un premier pas important, selon Anne-Marie Viguier, qui ne doit pas empêcher les consommateurs de continuer à se mobiliser et rappeler à leur responsabilité les grands industriels : « Il faut bien avoir conscience que les marques ne sont rien sans acheteurs. Nous avons un réel pouvoir ».
Anne-Marie Viguier
Membre de l’association CCFD-Terre Solidaire et coordinatrice locale du collectif Éthique sur étiquette.
Tous les articles du dossier ” Quand la mode a la fibre éthique “







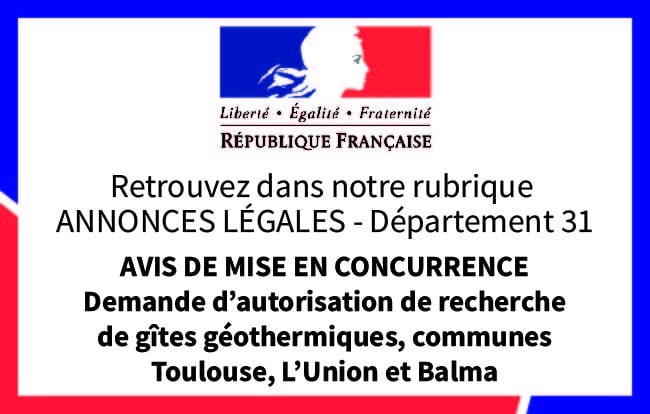

Commentaires