« Oser l’autre » pour intégrer des personnes en situation de handicap
1 décembre 2016 - 08:00
EMPATHIE – Bien qu’elles ne soient plus stigmatisées et rejetées comme il y a encore moins d’un siècle, les personnes en situation de handicap peinent encore aujourd’hui à être pleinement reconnues. Individuellement ou collectivement, notre société doit encore multiplier les efforts en ce sens.
«Contrairement à une certaine époque, le regard que nous portons sur les personnes en situation de handicap est davantage bienveillant. Mais attention à ce que l’arbre ne cache pas la forêt, il y a encore beaucoup de travail», estime Éric Dugas. Le directeur du département recherche en sciences humaines et sociales de l’université de Bordeaux, également chargé de mission handicap sur son campus, rappelle que ces publics étaient totalement rejetés avant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient par exemple privés d’éducation. Une première étape a été franchie avec l’indemnisation des handicapés de guerre, avant que les textes législatifs n’ouvrent progressivement leurs droits. Jusqu’à la loi de 2005 qui fait encore référence aujourd’hui.
Il y a quelques semaines, dans une tribune publiée sur le site de “L’Obs”, l’expert avait cependant constaté que les Jeux Paralympiques de Rio étaient moins diffusés, à des heures de moindre écoute et sur des chaînes secondaires, que les JO. «De même, si des programmes dédiés au handicap existent, certaines pathologies sont très peu montrées», estime Éric Dugas. Selon lui, c’est pourtant en habituant tout un chacun à côtoyer le handicap au quotidien que les mentalités connaîtront une évolution supplémentaire. Que nous passerons «de la connaissance à la reconnaissance». «À force d’être en contact, le handicap s’estompe, disparaît», ajoute-t-il.
“Si quelqu’un en fauteuil roulant dispose d’une rampe pour accéder à un bâtiment, il n’a pas de handicap par rapport aux autres.”
Le professeur des universités rappelle aussi l’importance de la terminologie : dire “personne en situation de handicap” plutôt que “handicapé” n’est pas une question de politiquement correct. «Il s’agit de ne pas ramener la personne à sa pathologie, à sa biologie, mais de constater sa situation par rapport à son environnement. Si quelqu’un en fauteuil roulant dispose d’une rampe pour accéder à un bâtiment, il n’a pas de handicap par rapport aux autres. Comme le disait Claude Lévi-Strauss, l’homme n’est pas le produit de son corps mais de ses techniques et de ses représentations.»
Sources : Agefiph et MDPH
Éric Dugas incite ainsi à «oser l’autre, par des gestes du quotidien». «Aller vers lui sans attendre quelque chose en retour. Lui proposer son aide comme on le ferait tout simplement avec un ami les bras trop chargés de bagages. Être dans l’empathie et non dans la compassion », poursuit-il. L’important, comme le rappelle l’expert, étant que les personnes en situation de handicap «vivent comme les autres mais avant tout avec les autres».
Au-delà de ces initiatives individuelles, notre société dans son ensemble doit encore progresser. Le travail restant bien évidemment le premier vecteur d’insertion, tout comme pour les personnes valides. «Aujourd’hui, sans emploi, difficile d’être indépendant. Or, on constate que l’accès aux études supérieures et au marché du travail reste plus compliqué pour les personnes en situation de handicap. Pourtant, il est facile d’adapter un poste de travail à quelqu’un. Il faut partir des compétences et ne pas être dans le manque», appuie Éric Dugas. Autrement dit : regarder ce que ces gens ont à apporter, pas ce qu’ils n’ont pas. Le professeur des universités appelle également à susciter les vocations pour les métiers d’accompagnement. Et de lancer un message d’espoir :«Le temps politique et institutionnel n’est pas forcément celui des personnes concernées et des familles. Ce sera long mais nous pouvons réinventer une société pour tous.»
À lire aussi :
Regardez ce handicap que je ne saurai voir.
Les solutions pour mieux intégrer les personnes en situation de handicap
Quand la culture bouscule les préjugés





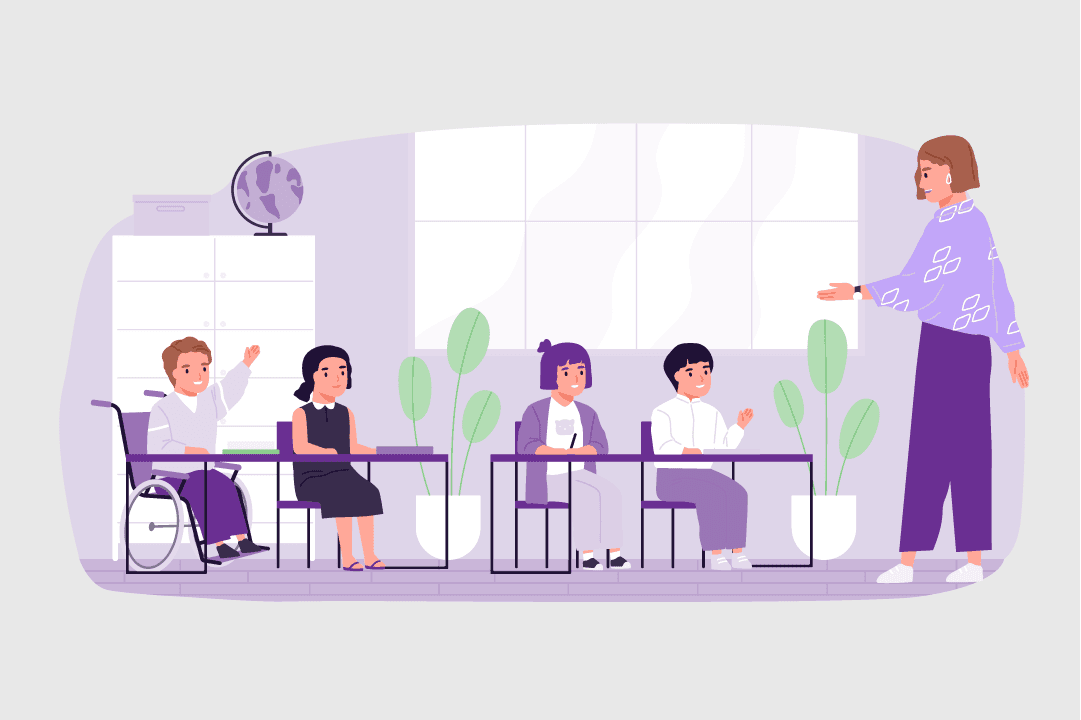
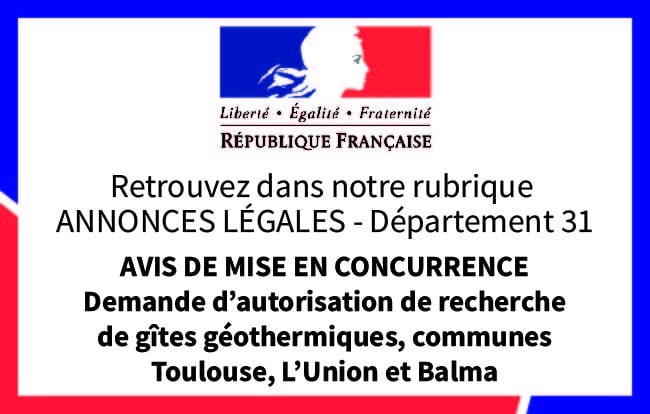

Commentaires