Journée internationale des droits des femmes : les scientifiques sortent de l’ombre
4 mars 2019 - 17:29
Elles n’en ont pas l’habitude. Pourtant, les femmes scientifiques seront mises à l’honneur au Quai des savoirs. Le 8 mars, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, leurs investissements, leurs travaux, leurs découvertes viendront démontrer, s’il en est besoin, leur importance dans le monde de la recherche et de la science. © Vincent Moncorgé. CNRS photothèque/association Femmes & Sciences
Si les filles représentent encore 50 % des lycéens inscrits dans la filière scientifique du baccalauréat, elles ne constituent ensuite plus que 35 % des effectifs travaillant dans la recherche. Et lorsqu’on lève la tête vers les hauts postes académiques, elles ne sont plus que 11 %. Quant au prix Nobel, les femmes se comptent sur les doigts de la main puisque 3 % des récompenses ont été attribuées à des scientifiques féminines depuis 1901.
« Les mentalités évoluent mais les chiffres parlent d’eux-mêmes », constate Magali Jacquier, ingénieure de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Cette vétérinaire l’avoue, elle a dû faire face à de nombreux stéréotypes dans sa profession : « D’autant plus que j’ai travaillé en Afrique sur la faune sauvage, un champ plutôt masculin. Mais avec l’expérience, on apprend à répondre aux blagues tendancieuses. »
Selon la scientifique, si les nouvelles lois sur l’égalité femmes-hommes ont permis de garantir la parité lors des concours, la progression des carrières est toujours plus lente pour les femmes. « Les postes de directeur de recherche sont essentiellement occupés par des hommes », observe-t-elle. Ces derniers ne cédant que trop peu de places à leurs homologues féminines, ce qui explique en partie la faible représentation des femmes dans les emplois à responsabilité dans ce secteur.
Mais les femmes ont également tendance à s’autocensurer. « Elles ne se sentent pas suffisamment légitimes, ne se considèrent pas comme des expertes sur des thèmes dont elles sont pourtant spécialistes. C’est le syndrome de l’imposteur », note Magali Jacquier. Pour combattre ces clichés, plusieurs associations organisent l’événement ‘’Les femmes scientifiques sortent de l’ombre’’.
Des rencontres pour faire la connaissance de femmes scientifiques
Le 8 mars, au Quai des savoirs, différentes rencontres mettront en lumière des scientifiques contemporaines et historiques. Un ”éditathon” d’abord pour que chacun enrichisse la base de données de Wikipédia qui compte encore trop peu de biographies de femmes scientifiques. Un atelier ensuite, sous forme d’une succession de jeux, pour expliciter ce qu’est un stéréotype et ne plus le véhiculer, même inconsciemment. Puis, une table ronde qui permettra de rendre hommage à celles qui ont fait avancer la science, mais que la postérité n’a pas retenues. Car si les femmes participent activement à certaines découvertes, leur nom n’apparaît nulle part. « Quand les recherches sont effectuées en équipe, les succès sont attribués à l’homme. Beaucoup sont pourtant réalisées par des femmes », commente Magali Jacquier, également coordinatrice de l’événement.
Afin de rectifier le préjugé selon lequel les laboratoires ne seraient bondés que d’hommes quinquagénaires en blouse blanche, le photographe Vincent Moncorgé exposera ses portraits de femmes scientifiques, qu’elles soient océanographes, biologistes, éthologues, mathématiciennes ou juristes. Un parcours à coupler avec la balade insolite organisée dans les rues de Toulouse pour aller à la rencontre de 12 femmes scientifiques qui n’ont pas – encore – leur nom sur une plaque de rue, mais qui ont contribué de manière décisive à l’avancée des connaissances. Histoire de rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre.







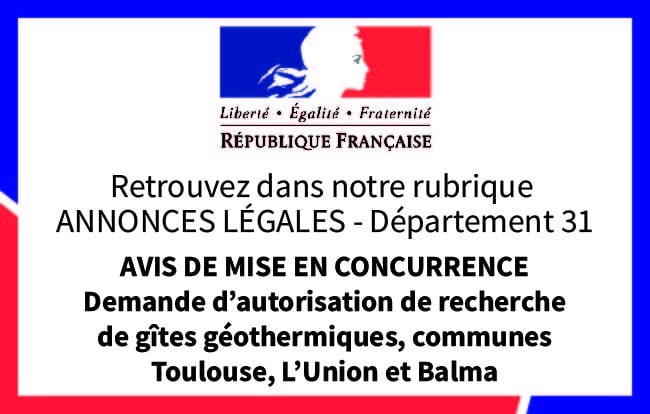

Commentaires