Une étude de l’Insee démontre que Toulouse ne dévore pas ses voisines
27 octobre 2019 - 10:39
Non, ce n’est pas le désert autour de Toulouse. Les aires urbaines qui l’entourent attirent, elles aussi, les nouveaux arrivants et les échanges ne sont pas aussi déséquilibrés qu’on ne le pense entre la Ville rose et ses voisines. C’est l’enseignement principal de la dernière étude sur notre territoire menée par l’Insee et l’agence d’urbanisme de Toulouse.
L’attractivité de Toulouse est forte, tout comme son influence sur ses territoires voisins. Ce que l’on appelle le système métropolitain toulousain est une vaste zone, peuplée de 2,3 millions d’habitants, qui rassemble notre aire urbaine (la ville et sa couronne) et celles de 17 communes moyennes, de Tarbes à Rodez et d’Agen à Carcassonne. Il s’agissait pour l’Institut national d’études statistiques (Insee) et l’agence d’urbanisme de Toulouse Aua/T de mesurer les échanges migratoires avec l’extérieur, ou à l’intérieur de cet ensemble. Ainsi, en 2014, près de 75 000 personnes s’y sont installées et près de 66 000 en sont parties, soit un solde annuel de 9000 habitants. Premier constat de l’étude : « Notre territoire est, certes, particulièrement attractif, mais pas davantage que ne le sont les autres systèmes de l’ouest de la France », indique Séverine Pujol, cheffe de projet à l’Insee Occitanie.
Les chiffres montrent ensuite que l’aire urbaine toulousaine ne capte que 55 % des nouveaux arrivants, soit un peu moins que son poids démographique (58 %). En revanche, elle polarise davantage les arrivées lointaines : « C’est un phénomène que l’on observe dans toutes les grandes métropoles et qui concerne principalement les étudiants et les cadres. Des populations mobiles sur de grandes distances, qui viennent profiter de l’offre de formation ou de la vitalité du tissu économique ».
Des échanges presque équilibrés entre Toulouse et ses voisines
Au regard de son poids démographique considérable au sein du système, l’aire urbaine de Toulouse pourrait générer des échanges de population très déséquilibrés. Pourtant ce n’est pas le cas : « Nous voulions vérifier cela. Et il apparaît que Toulouse ne mange pas tout, elle ne désertifie pas autour d’elle », confirme Séverine Pujol. En effet, en 2014, si 8 400 personnes qui habitaient dans l’une des 17 autres aires du système ont déménagé dans celle de Toulouse, il y en a 6 500 qui ont fait le chemin inverse.
Néanmoins, les disparités sont marquées : Figeac et Albi gagnent des habitants dans leurs échanges avec Toulouse, alors que Rodez, Castres ou Carcassonne en perdent. Les profils varient également : « Compte tenu de leur tissu économique, Saint-Gaudens ou Tarbes voient arriver davantage d’ouvriers. Alors que ce sont plutôt des familles et des cadres qui s’installent à Montauban, une ville plus proche et bien desservie par la route et le train. » Par ailleurs, Toulouse concentre nettement moins les échanges au sein du système lorsque l’on se restreint à la population non étudiante. Il y a alors davantage de déménagements entre les aires moyennes, mais ils sont principalement limités à des binômes de villes proches, comme Montauban et Castelsarrasin.
Flux de déménagements, profils des nouveaux arrivants, impact de la vie personnelle sur la localisation de sa résidence, l’état des lieux dressé par l’Insee et l’Aua/T enrichira la réflexion des élus, lorsque, en 2020, ils devront mettre à jour leurs projets de territoire ou schéma de cohérence territoriale. « Ils auront besoin de ces informations afin de connaître leurs futurs habitants et pouvoir leur offrir les logements et services qui correspondent à leurs besoins », conclut Séverine Pujol.
Philippe Salvador
Philippe Salvador a été reporter radio pendant quinze ans, à Toulouse et à Paris, pour Sud Radio, Radio France, RTL, RMC et BFM Business. Après avoir été correspondant de BFMTV à Marseille, il est revenu à Toulouse pour cofonder le magazine Boudu.
Voir les publications de l'auteurActualités en continu - Actualités
- Actualités
-
Toulouse
Toulouse : début des travaux d’une tour de 18 étages qui va transformer le paysage
24 février 2025 - 19:15
-
Actualités
Vacances de Noël en Andorre : un programme féerique dans les stations de ski
19 décembre 2024 - 18:03
-
Lot-et-Garonne
3 musées gastronomiques du Lot-et-Garonne où s’ouvrir l’appétit
7 décembre 2024 - 15:03
-
Actualités de l'Hérault
Occita’fun, le premier parc de loisirs indoor multi-activités de l’Hérault est lancé
1 décembre 2024 - 18:07
-
Toulouse
Découvrez les meilleurs spots pour voir le feu d’artifice à Toulouse le 13 juillet
29 juin 2024 - 09:02
-
Actualités des Pyrénées-Orientales
Pyrénées-Orientales : 137 communes bénéficieront de nouvelles aides économiques
28 juin 2024 - 20:41
-
Actualités de l'Aveyron
Pourquoi l’Aveyron est médaille d’or des aides agricoles de la PAC
25 avril 2024 - 16:31
-
Culture Gers
Mouss et Hakim du groupe Zebda en tête d’affiche au festival Welcome In Tziganie
23 avril 2024 - 15:26
-
Actualités du Tarn
Un maire du Tarn doit concéder l’installation d’un pylône dans son village
25 mai 2023 - 15:16



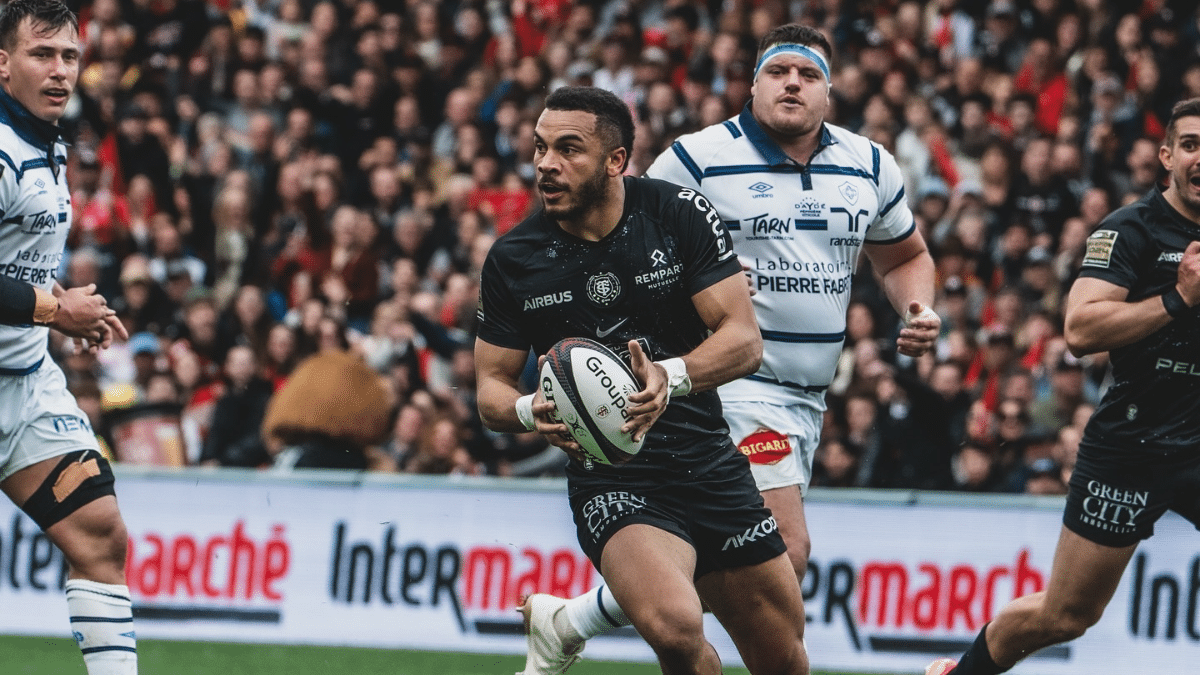





Commentaires